Pour un statut politique du producteur

Après la recension de l'ouvrage de Bernard Friot sur les retraites (ici), puis la présentation non-exhaustive de Versus, le lexique proposé par le Réseau salariat (ici), il s'agit là du texte fondamental du Réseau salariat (http://www.reseau-salariat.info/). On y trouvera, dans le "déjà là" du salariat, des possibilités concrètes de sortie de l'économie capitaliste .
Il est possible de rompre avec la logique du capital, qui décide seul de tout ce qui a trait à l’emploi et à la production, mais aussi avec la logique qui enferme le salarié dans son exploitation (qui se double souvent de son aliénation) et qui ne peut, au mieux, que revendiquer la reconnaissance de sa souffrance. Rompre avec cette logique nécessite de lui opposer l’expression positive de notre qualité de producteur, c’est-à-dire affirmer le fait que nous sommes les créateurs exclusifs de la valeur économique.
L’expression de ce potentiel impose de donner à ce qui le fonde, la qualification à la personne, toute la force du politique. C’est pourquoi nous proposons la création d’un droit universel à qualification, comme droit politique constitutionnel, appelé à devenir partie intégrante de la citoyenneté au même titre que le droit de suffrage. Ce droit instituera un statut politique du producteur, et se déclinera dans l’attribution d’une qualification personnelle à chaque citoyen dès l’âge de dix-huit ans. Cette qualification sera irrévocable, pourra progresser à l’ancienneté ainsi qu’au travers d’épreuves de qualification, et fondera pour son titulaire l’obtention d’un salaire à vie correspondant à son niveau de qualification.
1) Quelle est la situation ?
Le constat est aujourd’hui connu : dans le partage de la valeur ajoutée entre salaire et profit, le salaire, cotisation sociale comprise, a reculé de presque 10 points en trente ans dans la richesse que nous créons chaque année. Dans cette dynamique, tout le pouvoir économique et politique revient aux actionnaires, aux employeurs et aux prêteurs. Ils décident seuls de tout ce qui a trait à la production : où, par l’implantation de la production dans la division internationale du travail ; qui, par les stratégies d’embauche et de gestion de la main d’œuvre ; comment, par les investissements et l’organisation du travail ; quoi, par le type de marchandises produites.
Comment en sommes-nous arrivés là, malgré les millions de manifestants dans les rues, les blocages dans les entreprises, les grèves dans la fonction publique ? Pour deux raisons essentielles.
D’abord, parce que nous avons cédé au catastrophisme des idéologues et de leurs relais médiatiques qui disent que le gâteau à partager est de plus en plus petit, dans un contexte où l’emploi doit être préservé à tout prix, et, plus récemment, où la dette nécessiterait l’austérité : vieillissement de la population, dette publique et trou de la sécurité sociale, le tout face à la menace permanente du chômage, des concurrents étrangers, des délocalisations et maintenant des marchés. Autant de problèmes qui seraient, nous dit-on, techniques et non pas politiques ; inéluctables et non pas surmontables.
Ensuite, car nous n’avons pas su voir que des institutions déjà existantes, comme le salaire et la cotisation sociale, contiennent un extraordinaire potentiel d’émancipation du capitalisme et de la logique marchande. En effet, ces institutions permettent de subvertir le capitalisme car elles sont porteuses d’une alternative inouïe : la perspective d’une réappropriation du travail dans ses moyens et dans ses fins, en envisageant un statut politique pour les producteurs de richesse que nous sommes, libérés du capital et de la logique du profit.
En quoi ces institutions, salaire et cotisation sociale, sont-elles déjà porteuses d’une subversion du capitalisme ? En ce qu’elles prouvent que nous socialisons déjà la quasi moitié de la valeur produite chaque année pour assurer, et avec succès depuis des dizaines d’années, le financement de la sécurité sociale, des services publics et de la pension de millions de retraités en nous passant d’employeurs, d’actionnaires et de prêteurs. Il nous faut donc étendre la socialisation du salaire pour être définitivement libérés de cette triade, en nous appuyant, comme nous allons le voir, sur la qualification personnelle, dont est porteur chaque producteur.
Ne pas prendre collectivement conscience de ces potentialités nous enferme dans une logique de lutte contre des privilèges (qualifiés d’« excessifs ») et nous précipite dans une spirale d’échecs annoncés malgré des mobilisations répétées et importantes (la lutte massive contre la réforme des retraites l’a très récemment illustré). Ne pas approfondir et étendre les potentialités de ce « déjà-là » du salaire et de la cotisation nous oblige à nous contenter de victoires bien réelles, comme le rejet du Traité Constitutionnel Européen (TCE) en 2005 et le retrait du Contrat Première Embauche (CPE) l’année suivante, mais défensives avant tout.
Nous avons la possibilité de changer notre destin de « mineurs sociaux » soumis au nombre, au lieu et à la qualité des emplois décidés par le capital et ses détenteurs. Nous pouvons devenir des « majeurs sociaux », c’est-à-dire des producteurs décidant souverainement et collectivement des moyens et des fruits de notre travail. L’horizon du possible devient alors celui d’un fonctionnement où chaque producteur est reconnu comme décisionnaire de la production et de la répartition de la richesse collectivement produite. Cela n’est rien de moins qu’une extension du champ de la citoyenneté qui s’ouvre à nous.
2) Le partage de la valeur ajoutée est politique
Reconnaissance et déni du travail
Parce qu’il est l’unique source de création de richesse économique, c’est dans le travail que se situe aujourd’hui plus que jamais l’enjeu de la lutte entre les salariés et les détenteurs de propriété lucrative. C’est le travail qui permet de produire la valeur économique correspondant au salaire des salariés, mais aussi la valeur socialisée sous forme de cotisation. Cependant, la propriété lucrative donne le droit à quelques uns de ponctionner et de disposer d’une partie de cette valeur. Autrement dit, la propriété lucrative donne le droit à quelques uns de s’approprier une partie du fruit du travail de tous les autres, pour décider seuls des moyens et des fins de la production. L’affrontement a donc lieu entre le salaire, cotisation sociale comprise, et le profit ponctionné sur le travail au nom de la propriété lucrative. Or, cet enjeu a été oublié depuis trente ans, car lui a été substitué celui de l’emploi, qui enferme la production de valeur économique dans une logique marchande, subordonnée à un employeur et à travers lui, au pouvoir grandissant des actionnaires.
Pourquoi pointer ainsi du doigt ce qu’est devenu « l’emploi » et dénoncer la logique du « plein emploi » comme instrument d’asservissement des travailleurs à un employeur et à la logique marchande qu’il impose nécessairement ?
Pour y répondre, commençons par préciser que nous désignons par « travail » toute activité productrice de valeur d’usage à laquelle est reconnue une valeur économique. Avant même la détermination du montant de la rémunération du travail, la reconnaissance d’une activité comme travail est donc l’objet d’une décision de nature politique. C’est ainsi qu’élever un enfant ou prendre soin d’une personne âgée sont des activités dont l’utilité sociale est assurément admise, mais qui, lorsqu’elles sont réalisées par un parent ou un proche, ne sont pas reconnues comme du travail, c’est-à-dire productrice de valeur économique. Ces activités le deviennent en revanche lorsqu’elles sont accomplies par une puéricultrice ou par un infirmier.
Nous le voyons, toute activité n’est pas travail. En effet, l’activité n’est reconnue comme du travail que par l’intermédiaire d’un support. Or, ce support, c’est aujourd’hui principalement l’emploi. En effet, l’emploi définit le cadre d’exercice dans lequel sont payés les employés du secteur privé et les contractuels des services publics. Pourtant, il existe d’autres supports de reconnaissance de l’activité comme étant du travail : à côté du statut de travailleur indépendant, il existe surtout le support de la qualification personnelle au nom de laquelle les fonctionnaires et les retraités sont payés. Or, si la qualification personnelle possède un caractère émancipateur (que nous allons préciser), l’emploi est aujourd’hui le cadre majoritaire d’exercice du travail. Il est vrai que l’emploi confère des droits aux employés (notamment par les conventions collectives), il reste que reconnaître ce qui est du travail ou ce qui n’en est pas par l’intermédiaire de l’emploi pose un problème politique majeur : cette reconnaissance est soumise au pouvoir de l’employeur.
Si l’emploi a d’abord été la matrice de construction de droits pour les salariés, cette tendance s’est inversée durant ces trente dernières années pour servir à déqualifier les producteurs. Expliquons-nous. C’est au nom de l’emploi, qu’ont été décidés par nos gouvernants successifs : le gel du salaire depuis 1983 (le « tournant de la rigueur » de Mitterrand devenu aujourd’hui la « modération salariale ») ; le gel du taux de cotisation patronale de la retraite depuis 1979 et de la santé depuis 1984 ; le gel de la cotisation patronale de l’indemnité des chômeurs depuis 1993 et celui du taux de cotisation salariale depuis le milieu des années 90. C’est aussi au nom de l’emploi que les gouvernements ont créé des exonérations massives de cotisation sociale pour les emplois jugés les moins qualifiés, compensées par la fiscalité ; instauré le chantage au chômeur qui ne serait pas assez actif pour chercher un emploi, en lui retirant son indemnité et en le rendant coupable de son (mauvais) sort. C’est enfin au nom de l’emploi que s’étend la flexibilisation de la main d’œuvre pour la contraindre.
Ces reculs ont été initiés tout d’abord sur les « jeunes », dont la catégorie se généralise opportunément dès la fin des années 1970, ainsi que sur les chômeurs de longue durée. Les fonctionnaires, les agents des entreprises publiques et les travailleurs précaires en font aussi l’expérience depuis une dizaine d’années, de même que les « travailleurs vieillissants » devenus des « seniors » à mettre à tout prix au travail, comme l’a démontré la récente réforme des retraites. Dans un contexte de crise, le débat se polarise sur l’accompagnement des perdants (« pas assez employables » et vivant aux crochets d’une « France qui se lève tôt »), que la « cohésion sociale » doit toutefois contenir face à leur nombre grossissant. Quant à ceux qui « travaillent », ils sont désormais sommés de se considérer chanceux d’avoir (encore) un emploi.
Affaiblir la cotisation c’est affaiblir le salaire
Le salaire et la cotisation sociale sont devenus des coûts à réduire et des charges à limiter, y compris pour les syndicats et les partis dits de gauche qui ont adopté la rhétorique patronale du « coût du travail ». Des « solutions » sont cependant mises en œuvre, en particulier pour « sauver » la protection sociale. Lesquelles ?
D’abord, faire assumer le manque à gagner par les ménages, via la fiscalité, au lieu de continuer à le retirer sur le profit. C’est le rôle surtout de la CSG , payée à 90% par les ménages et 10% par le capital. Ce sera la même chose avec la TVA sociale ou avec le projet de fusion IRPP -CSG, qui vise à fractionner artificiellement la sécurité sociale entre risques dits « universels » (santé, famille) et « risques professionnels » (retraite, chômage), alors même que les modes de fonctionnement sont similaires. Or la fiscalité crée, par les mécanismes de l’assistance, des catégories de « riches » et de « pauvres » (ou de « travailleurs pauvres ») que la cotisation sociale et le salaire permettaient précisément de dépasser. Qu’on en juge par l’impôt sur les grandes fortunes ou, plus récemment, par le « paquet fiscal » d’un côté, le minimum vieillesse, la CMU ou le RSA de l’autre ! La fiscalité dénie le conflit capital/travail en lui substituant la lutte pour une meilleure redistribution entre riches et pauvres (au nom de la « justice sociale »).
Ensuite, le « sauvetage de la protection sociale » exige la limitation de la hausse des salaires et des prestations sociales. Cela s’est fait par l’indexation des retraites sur les prix et non plus sur les salaires depuis 1987, la limitation du taux de remplacement de l’indemnité des chômeurs relevant de l’assurance chômage à 57% du salaire de référence, le déremboursement partiel ou total des soins, le conditionnement des allocations familiales en fonction des ressources du ménage.
Enfin, ce « sauvetage » s’effectue par l’augmentation de la durée de cotisation pour un taux plein (retraite) ou la limitation de la durée de versement de la prestation en fonction de la durée de cotisation (c’est par exemple le cas des indemnités pour les chômeurs). Bref, par le renforcement ce que l’on appelle la contributivité, c’est-à-dire le versement de prestations, de pensions ou d’allocations strictement proportionnelles aux cotisations passées. La contributivité donne ainsi l’illusion que l’on cotise pour soi, dans la fiction d’un revenu qui serait différé (après avoir été conservé dans un « congélateur à valeur »). Ce que les réformateurs n’ont cessé de justifier par des considérations liées à l’équité : plus je cotise, plus j’ai droit.
Contre l’impôt, la cotisation sociale a fait ses preuves et peut être étendue
Contre ces « solutions » qui vont à l’encontre de la socialisation du salaire par la cotisation sociale, il convient d’en réaffirmer le sens et l’usage. Qu’est-ce que la cotisation sociale ? C’est une fraction de la valeur économique créée aujourd’hui par le travail de tous et servant à payer aujourd’hui même le retraité, le malade et son soignant, le chômeur, les parents.
Ce faisant, la cotisation sociale prouve que l’épargne est inutile : les quelques 400 milliards d’euros annuels de cotisation sont collectés par l’Urssaf qui les transforme immédiatement en pensions, remboursements de soins, indemnités journalières maladie et salaires du corps médical, indemnités chômage, allocations familiales. Le temps de la transformation n’excède pas la journée. Ceci signifie que, contrairement à une assurance privée, un système d’épargne salariale ou encore un fonds de pension, la cotisation sociale ne fait pas l’objet d’accumulation financière : 1 euro prélevé devient 1 euro versé. Nul besoin de s’endetter et de recourir au crédit auprès d’un prêteur.
Ensuite, la cotisation sociale prouve que l’on peut se passer du crédit pour des engagements longs et massifs. En effet, elle est capable de fournir un salaire dans les situations de « hors emploi » : depuis 1945, des millions de personnes, les retraités, soignants, malades, chômeurs et parents, ont pu et peuvent encore recevoir un salaire sur le long terme et être ainsi reconnu comme producteur de valeur économique sans subir le joug de l’emploi.
À partir de ce succès incontestable, une double extension de la cotisation sociale est possible : une extension à ce qu’elle finance déjà mais aussi à ce qu’elle peut d’ores et déjà financer. La cotisation sociale peut donc mieux payer les pensionnés et les soignants, mieux rembourser les malades, mieux indemniser les chômeurs, mieux payer les parents et en plus grand nombre. Elle peut en outre financer les frais locatifs, les frais de transports et payer les étudiants. Mais il est possible d’aller encore plus loin : au-delà de l’extension immédiate que nous venons d’esquisser, la cotisation sociale peut nous inspirer pour un projet bien plus ambitieux que nous allons à présent développer.
3) Le potentiel émancipateur du salaire repose sur son caractère politique
La cotisation sociale, comme le salaire, ne sont pas des ressources monétaires comme les autres : toutes deux se définissent par trois caractéristiques. Elles sont un barème, elles sont négociées collectivement et sont fondées sur la qualification professionnelle. En précisant la nature de ces trois caractéristiques, nous montrerons en quoi la qualification professionnelle est le pivot sur lequel nous pouvons prendre appui pour fonder le statut politique du producteur.
Le taux de cotisation sociale, le taux de remplacement ainsi que l’attribution de la cotisation sociale aux différents secteurs qu’elle couvre, repose sur les décisions des organisations syndicales et patronales, dans un cadre étatique. Ces taux sont donc des barèmes, en ce sens qu’ils sont le produit de délibérations politiques. Ces barèmes permettent ainsi d’attribuer aux qualifications professionnelles définies collectivement une valeur économique. À travers ce fonctionnement délibératif, nous sommes donc à l’opposé de la fixation du prix de la main-d’œuvre en fonction des aléas du marché.
Entendons-nous bien : la qualification professionnelle, sur laquelle est adossée le salaire et, donc la cotisation sociale (qui est un pourcentage du salaire brut), exprime la capacité du travailleur à produire de la valeur économique. C’est sur cette base que le salaire est payé. Si les mécanismes et les acteurs qui déterminent la qualification professionnelle ne sont pas les mêmes dans le secteur privé et dans la fonction publique, la qualification professionnelle n’en demeure pas moins, dans les deux cas, l’expression d’une délibération politique.
Ainsi, dans le secteur privé, c’est la convention collective, résultat de la délibération, encadrée par l’État, entre les représentants des salariés et du patronat, qui articule salaire et qualification professionnelle. Dans le secteur public, ce sont les instances paritaires — représentants de l’administration et représentants des fonctionnaires — qui définissent le statut de la fonction publique, en particulier le grade du fonctionnaire. Ce grade exprime sa qualification professionnelle et détermine le salaire (indice) correspondant. Il est justifié de parler ici de salaire à vie : le fonctionnaire le touche tout au long de sa carrière et au-delà dans sa pension, selon la progression régulière du grade et des épreuves de qualification qu’il passe.
La qualification professionnelle contient donc une dimension politique, qui exclut qu’on appréhende le travailleur comme un employable, soumis en permanence aux attentes et aux volontés des seuls employeurs. Le porteur d’une qualification professionnelle ne peut être réduit à une marchandise sur un « marché du travail », payée à son prix ou à sa productivité. À l’inverse de cette logique, c’est sur la qualification professionnelle que reposent la cotisation sociale et le salaire (salaire à vie dans le cas du fonctionnaire). La qualification professionnelle, n’est donc pas un attribut banal du poste ou du salarié, elle en est sa qualité centrale.
Voilà pourquoi toute l’entreprise de réforme engagée depuis plus de 30 ans vise précisément à disqualifier les salariés comme producteurs de valeur économique, dans le but de les enfermer dans un univers marchand où la délibération politique n’a plus droit de cité. Ainsi faut-il comprendre les attaques contre les statuts professionnels (fonction publique, régimes spéciaux, intermittents du spectacle, etc.), le développement des rémunérations conditionnées à l’atteinte d’objectifs, la substitution de la « compétence » à la qualification et le développement d’une fiscalité tutélaire en lieu et place du salaire (contrats aidés, crédits d’impôt, etc.).
La cotisation sociale a aussi subi les assauts des « réformateurs », à travers la limitation de la portée démocratique de la gestion des caisses : alors que les décisions prises au sein des caisses de sécurité sociale étaient portées aux 2/3 par les représentants des salariés avant les ordonnances de 1967, elles sont devenues paritaires à cette date, avant d’être de plus en plus soumises aux choix gouvernementaux (notamment à travers la loi Juppé en 1996, déterminant les conventions d’objectifs et de gestion de la sécurité sociale).
Ajoutons que les assauts contre le salaire et la cotisation passent aussi par l’imposition d’un vocabulaire qui construit les représentations suivantes : tandis que les cotisations sociales sont devenues des « charges sociales », voire une « taxe sur le travail », les salaires et les salariés sont des « variables d’ajustement » en cas de difficulté de l’entreprise ou en cas de crise économique.
Au centre de l’attaque des « réformistes », il nous faut donc mesurer l’enjeu représenté par la cotisation sociale, la qualification professionnelle et le salaire à vie des fonctionnaires : parce qu’elles procèdent d’une délibération collective, mais aussi parce qu’elles desserrent l’étau de l’employabilité, ces institutions du salariat doivent être consolidées.
4) Consolider le statut politique du salarié :
s’inspirer du statut du fonctionnaire et de l’expérience des retraités
Forces et faiblesses de la qualification du poste
La qualification professionnelle attribuée au poste est une avancée. En effet, elle contribue à déconnecter le salaire d’une contrepartie directement liée à une production (le nombre de vis fabriquées par exemple) ou au prix de la force de travail. Répétons-le, le salaire qu’elle définit est un barème issu d’une convention.
En outre, la qualification professionnelle du poste est très différente de la « compétence » qu’on tente aujourd’hui de lui substituer. Alors que la qualification professionnelle est le résultat d’une négociation collective et s’impose à tous les employeurs, la compétence est du seul ressort de ces derniers, échappant ainsi à toute définition collective. Elle ramène le salarié à la condition de simple force de travail.
Cependant, la qualification professionnelle présente une faiblesse importante dans les entreprises du secteur privé : étant attribuée au poste de travail, le salarié n’en est doté que le temps de l’occupation de ce poste (durée du contrat). C’est-à-dire qu’il n’est pas porteur de cette qualification en personne. Il la perd dès lors qu’il perd son emploi. Autrement dit, en perdant son poste de travail, il perd du même coup la qualification professionnelle du poste qu’il occupait et le salaire qui va avec. Il est réduit à devenir un demandeur d’emploi. L’accès à un nouvel emploi de niveau de qualification au moins équivalent à celui qu’il a perdu ne lui est pas garanti, moins encore depuis l’instauration de l’offre raisonnable d’emploi en 2009.
La qualification à la personne des fonctionnaires et des retraités : un exemple à suivre
La faiblesse de la qualification du poste dans le secteur privé est surmontée dans la fonction publique, où les droits salariaux (qualification et salaire) ne sont pas attribués au poste de travail mais à la personne. En effet, comme nous l’avons présenté plus haut, la qualification professionnelle du fonctionnaire s’exprime à travers son grade. De ce grade, le fonctionnaire en est titulaire à vie, tout comme l’agent de l’entreprise publique l’est de son groupe fonctionnel : le fonctionnaire transporte son grade dans ses mobilités professionnelles. Ce grade devient ainsi un attribut inaliénable de sa personne. C’est pourquoi il n’y a pas de chômage dans la fonction publique. Au contraire, le statut de fonctionnaire implique une grille indiciaire qui assure à son titulaire une progression automatique de sa qualification et de son salaire. De plus, son statut ne se confond pas avec le métier qu’il exerce : il bénéficie d’une relative transversalité des tâches qu’il peut accomplir en changeant de poste. Quant à sa mobilité, il peut l’obtenir sur un motif étranger à l’emploi, comme le rapprochement de conjoint. Le statut du fonctionnaire, en combinant qualification personnelle et salaire à vie, montre donc la voie de l’émancipation du salarié vis-à-vis du lien de subordination qui le lie à un employeur, ainsi que de la dictature de la mise en valeur du capital pour le compte de l’actionnaire.
Mais il n’y a pas que les fonctionnaires qui se voient attribuer en personne, et non selon le poste qu’ils occupent, une qualification personnelle inaliénable, et donc un salaire à vie. Les retraités qui perçoivent une pension du régime général font, eux aussi, l’expérience quotidienne d’être payés pour travailler en étant libérés de l’employeur. Et c’est précisément parce que les retraités sont payés à vie et disposent de leur temps à leur guise qu’ils disent si souvent être heureux. En s’occupant de leurs petits-enfants, en exerçant des responsabilités associatives ou politiques, en cultivant leur potager, ils travaillent tout en ayant l’assurance d’être payés. Se limiter et réduire ces activités à leur caractère « utile » serait trompeur. Ce serait s’interdire de mesurer les voies émancipatrices dont leur expérience quotidienne est porteuse : les retraités nous montrent en effet qu’il est déjà possible de travailler en étant libéré de la contrainte de valoriser le capital en produisant des marchandises nécessaires à son développement.
En conclusion, que nous apprennent le statut du fonctionnaire et la situation des retraités ? Qu’il est possible de travailler hors du marché du travail et de l’emploi, grâce à l’attribution d’une qualification personnelle et d’un salaire à vie. Parallèlement, la cotisation sociale ouvre une perspective à ce jour encore inexplorée : celle de faire des salariés que nous sommes des producteurs dotés d’un statut politique leur permettant de maîtriser l’investissement. Autrement dit, il s’agit de lier les trois termes suivants, constitutifs du salariat émancipé : premièrement, la qualification personnelle en tant qu’expression du potentiel de création de valeur économique du travailleur, ensuite, le salaire à vie qui lui correspond, enfin, la cotisation sociale comme technologie de financement permettant la maîtrise de la répartition de la valeur ajoutée. L’articulation de ces trois termes porte en elle la possibilité révolutionnaire de transformation du salarié en un sujet politique dans une organisation de la société véritablement démocratique.
5) Vers un statut politique du producteur
Le droit universel à la qualification
Nous l’avons dit en ouvrant ce texte, nous pouvons rompre avec la logique du capital, qui décide seul de tout ce qui a trait à l’emploi et à l’investissement au nom du droit de propriété lucrative. Sortir de la logique qui enferme le salarié dans son exploitation (qui se double souvent de son aliénation) et qui ne peut, au mieux, que revendiquer la reconnaissance de sa souffrance, nécessite donc de lui opposer l’expression positive de la qualité du producteur.
Il s’agit donc d’instaurer un statut politique du producteur, s’étendant à toutes les catégories de travailleurs, qu’il s’agisse de salariés de la fonction publique ou du secteur privé, des travailleurs indépendants, des actuels retraités, parents, chômeurs et étudiants. Ce statut politique institue le producteur en créateur et décideur unique de la valeur économique.
L’expression de ce potentiel impose de donner à ce qui le fonde, la qualification à la personne, toute la force du politique. C’est pourquoi nous proposons la création d’un droit universel à qualification, comme droit politique constitutionnel, appelé à devenir partie intégrante de la citoyenneté au même titre que le droit de suffrage. Ce droit instituera un statut politique du producteur et se déclinera dans l’attribution d’une qualification personnelle à chaque citoyen dès l’âge de 18 ans. Cette qualification sera irrévocable, pourra progresser à travers l’ancienneté ainsi qu’à travers des épreuves de qualification, et fondera pour son titulaire l’obtention d’un salaire à vie correspondant à son niveau de qualification.
Le droit universel à qualification constituera donc un enrichissement de la citoyenneté de même portée que le droit universel de suffrage. Alors que le droit de suffrage reconnaît déjà l’aptitude de chacun à participer à la décision politique, le droit à la qualification reconnaîtra l’aptitude de tous à participer à la production et à déterminer les moyens (les conditions de sa réalisation) et les fins de cette dernière (son objet).
Étendre la cotisation sociale à l’ensemble de la valeur ajoutée
Le pouvoir de déterminer les moyens et les fins de la production ne se définit pas seulement par le droit à la qualification, mais aussi par la maîtrise de l’investissement. En effet, maîtriser démocratiquement l’investissement est à notre portée, cela contre la propriété lucrative, au nom de laquelle les soi-disant « investisseurs » prétendent légitimer la ponction sans cesse accrue qu’ils opèrent sur la valeur ajoutée.
Pour ce faire, la cotisation sociale est notre modèle : collectivement délibérée et répartie sans passer par l’accumulation financière ni le crédit, elle a fait ses preuves en finançant pendant des années la santé, la retraite, le chômage et la famille. Cette réussite fonde la possibilité de son extension pour financer l’investissement.
Cette extension peut opérer à travers une cotisation-investissement (ou cotisation économique), répartie par des caisses d’investissement créées sur le modèle actuel des caisses de sécurité sociale, et dont la gestion démocratique serait le pendant. Une telle extension de la cotisation ouvre à la maîtrise des choix, des moyens, des conditions, des objets et des niveaux de production par ceux qui créent la valeur économique.
L’horizon du possible s’étant désormais ouvert, reste à envisager les conditions qui permettront non seulement de réaliser cet objectif, mais encore de le rendre pérenne. Si le statut politique du producteur est la modalité centrale de l’émancipation de ce dernier, il s’agit à présent d’identifier les conditions rendant faisables la construction et l’exercice de cette émancipation.
À ce stade, les questions soulevées sont plus nombreuses que les réponses que nous pouvons d’ores et déjà apporter. Cependant, il y a lieu de distinguer l’essentiel de l’accessoire, ou du moins, de ce qui en découle. En effet, l’essentiel – la mise en place d’un statut politique du producteur et les potentialités révolutionnaires dont il est porteur – ne saurait être confondu avec l’ensemble des questions qui accompagnent la mise en place concrète de ce statut. Celles-ci peuvent être résolues dans ce cadre pratique et de manière collective.
6) Questions ouvertes
Plusieurs registres d’interrogations peuvent être distingués, dès lors que l’on passe de l’identification des possibles émancipateurs dans le « déjà là » à la perspective concrète de leur extension. Nous en présentons six d’entre eux, que nous illustrons à travers des questions légitimes, suscitées par cette perspective.
Un premier registre concerne l’âge d’attribution d’une qualification à la personne. Si nous avons précédemment proposé 18 ans, c’est avant tout pour faire coïncider majorité « productive » et majorité politique telle qu’elle est aujourd’hui (et seulement depuis 1974) établie dans la société française. Il serait cependant possible d’attribuer une qualification à une personne plus tôt, dès 16 ans, âge légal de fin de la scolarité obligatoire, afin de combler le déficit de reconnaissance qui caractérise la période 16-18 ans en termes de droits et de ressources.
Un deuxième registre concerne l’universalité du droit à qualification et donc du droit à un salaire à vie. À ce sujet, une objection récurrente a trait au fait d’octroyer un salaire à une personne qui ne « ferait rien » et/ou qui ne « voudrait rien faire » — ce qui n’est pas, du reste, une question propre au fonctionnement d’un système socialisé. Nous ne discuterons pas ici des raisons et des mécanismes qui permettent la reconnaissance d’une activité en travail. Nous nous contenterons de souligner deux points. De fait, il est moins nuisible de ne « rien faire » que de « faire » quantité d’activités accomplies actuellement dans l’emploi, qu’il s’agisse de la culture de semences non-reproductibles, de la production de médicaments ou d’implants toxiques, de mathématiques appliquées à la finance, ou autres. Le salaire à vie donnerait au contraire aux salariés confrontés à ces situations la possibilité de décider « d’arrêter de faire » de telles activités. Ensuite, il s’agit de ne pas perdre de vue que la question n’est pas de savoir « en contrepartie de quelle activité concrète » un salaire est attribué, mais « au nom de quoi ». L’actionnaire, qui prélève des dividendes au nom de la propriété lucrative, ne « fait rien » en termes d’activités concrètes. À l’inverse, le salarié est payé au nom de sa qualification personnelle, c’est à dire de sa capacité, politiquement reconnue et garantie, à décider et créer de la valeur économique. Enfin, la progression de la qualification personnelle pourrait, comme dans l’actuelle fonction publique, articuler à la fois la progression à l’ancienneté et des épreuves dont la réussite serait évaluée par un collectif de travail, en s’inspirant par exemple du modèle actuel de la validation des acquis de l’expérience (VAE).
Un troisième registre tient à la question de la hiérarchisation des qualifications, et donc des salaires. En effet, comment concevoir l’existence d’une société dont les membres seraient émancipés et la valeur ajoutée entièrement socialisée alors même que subsisteraient des différences de salaire, basées sur une hiérarchie des qualifications ? Pour répondre, rappelons d’abord que notre approche du statut politique du producteur se base sur le « déjà là » émancipateur des institutions du salariat, cela dans une optique de faisabilité. Or, il nous semble que rien, dans ces institutions, n’anticipe à ce jour une égalité totale des salaires, ni la suppression de critères déterminant des niveaux de salaire. Pour cette raison, la suppression des hiérarchies ne nous paraît pas réaliste à court terme. Cependant, si des hiérarchies sont maintenues, les écarts entre les différentes catégories salariales peuvent être considérablement réduites au regard des inégalités actuelles. Un rapport de 1 à 20 entre la catégorie la plus basse et la plus élevée, comme l’a proposé la Confédération Européenne des Syndicats (CES) et à sa suite le Front de Gauche, est-il acceptable ? Pour notre part, nous considérons qu’un tel écart est trop important et optons pour une échelle des qualifications et des salaires allant de 1 à 4 ou de 1 à 5. Nous nous rapprochons en cela des pratiques en vigueur dans le monde coopératif et du rapport actuel entre les salaires les plus élevés et les salaires les plus faibles en France . Enfin, cette hiérarchie peut être rendue effective à partir de l’expérience de critères non marchands, s’inspirant par exemple là encore des procédures de validation des acquis de l’expérience.
Un quatrième registre a trait à la nature de la propriété à laquelle le statut du producteur entend mettre un terme. Entendons-nous bien, l’établissement d’un statut politique du producteur permettra de supprimer l’ambiguïté constitutive de l’actuel droit de propriété. En effet, celui-ci recouvre de manière indifférenciée, d’une part la propriété d’usage, c’est-à-dire l’exclusivité et la liberté d’utilisation d’un bien comme une maison ou une voiture, et d’autre part la propriété lucrative, qui permet à un individu de tirer un revenu de la propriété d’un bien qu’il n’utilise pas, comme un loyer, ou du travail d’un autre, comme dans le cas de la rente actionnariale. On l’aura compris, seule la propriété lucrative est abolie par le statut politique du producteur, qui permettra de ce fait d’étendre considérablement le périmètre de la propriété d’usage.
Un cinquième registre est lié à l’usage de la monnaie dans le cadre d’une société reconnaissant politiquement l’ensemble des producteurs comme unique créateur de valeur économique. Pourquoi ne pas pousser la socialisation de toute la valeur ajoutée au point de réaliser une gratuité généralisée, en s’inspirant du modèle du service public et en l’étendant ? Encore une fois, notre point de vue est déterminé par les institutions salariales déjà existantes, qui ne nous permettent pas de proposer, pour l’heure, une abolition pure et simple de la monnaie. En revanche, il semble possible d’envisager une création et un usage de la monnaie qui ne soient pas enfermés dans une double soumission à l’égard des banques privées et de la mise en valeur du capital. Pour cela, il faut que deux conditions soient impérativement réunies : d’une part, le retour exclusif du droit d’émission monétaire à la puissance publique, et d’autre part, un usage de la monnaie aux fins exclusives de rémunération de la qualification individuelle et de financement des investissements.
Un sixième registre d’interrogations est lié à la qualité politique du producteur, et aux limites territoriales et nationales de son statut. Dès lors que le statut politique du producteur enrichit la citoyenneté telle que nous la connaissons aujourd’hui, la constitutionnalisation d’un nouveau droit politique universel à qualification substituerait-il alors au peuple le salariat comme corps souverain ? Par ailleurs, comment articuler citoyenneté politique (conférant des droits et des devoirs sur la base de la nationalité) et citoyenneté productive (liée au travail) ? Ce qui revient à interroger l’échelle territoriale et les limites d’exercice de cette maîtrise. Devons-nous considérer l’exercice des droits à l’échelle de l’entreprise, à l’échelle nationale, imposer un cadre transnational règlementé, ou bien encore inventer une combinaison et une articulation de ces trois niveaux ?
En soulevant ces interrogations, nous préfigurons la vitalité démocratique qui accompagnera la constitutionnalisation de ce droit politique universel.
En signant collectivement ce texte, les membres du Réseau salariat invitent chacune et chacun à considérer dans le « déjà-là » des institutions du salariat, les leviers concrets de son émancipation.
N’hésitez pas à contacter le Réseau salariat à l’adresse coordinateur@reseau-salariat.info pour proposer une occasion de formation, un article ou tout autre document, interroger sur une date ou un lieu de formation, un point de théorie, suggérer des idées touchant au site web : nouvelle rubrique, ajout de contenus, etc.


 Vérifiez sur
Vérifiez sur 



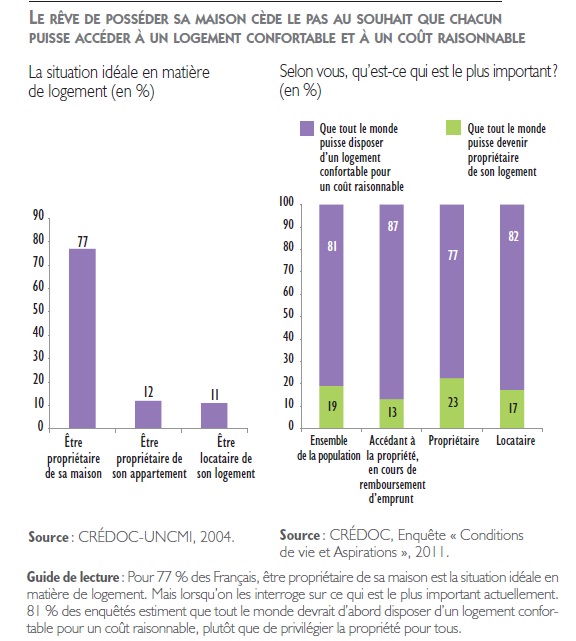
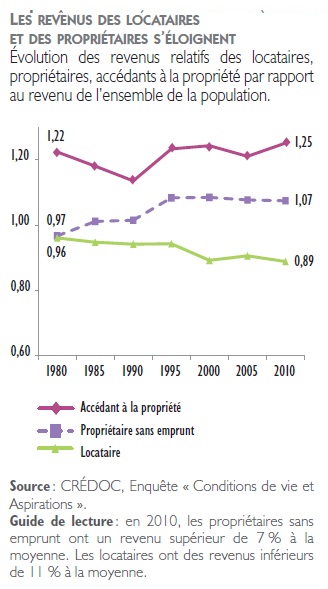
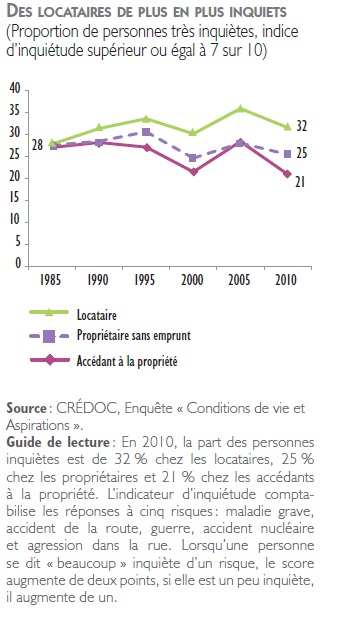
 Rappeler que Wes Anderson est d’origine texane (il est né à Houston) paraît incongru pour autant qu’on identifie (et réduit) cet état des Etats-Unis à l’imaginaire raciste diversement incarné par George W. Bush, Chuck Norris, les Texas Rangers et les Minute Men. L’incongruité est renforcée par le monde de références culturelles dont s’est doté un réalisateur qui, depuis son premier long métrage Bottle Rocket (1996), semble avoir été envoûté à jamais par les « Swinging Sixties », comme s’il n’était jamais revenu du Londres de 1967 et du Paris de 1968 (qu’il n’a pourtant pas connus puisqu’il est né le 1er mai 1969). Sept longs-métrages plus tard (Rushmore en 1998, The Royal Tenenbaums en 2001, The Life Aquatic with Steve Zissou en 2003, The Darjeeling Limited précédé par le court-métrage Hôtel Chevalier en 2007, le film d’animation Fantastic Mister Fox d’après Roald Dahl en 2010 et désormais Moonrise Kingdom projeté en ouverture de la sélection officielle de la 65ème édition du Festival de Cannes) parachèvent un geste esthétique dont la griffe stylistique, dorénavant parfaitement établie, est immédiatement reconnaissable. Plans fixes et frontaux, raccords à 180°, travellings latéraux fonctionnant comme des coupes transversales, panoramiques rapides donnant l’impression d’un espace scénographique à l’image d’un cube tournant sur lui-même, ralentis lyriques et voluptueux, couleurs pop et acidulées, effets de rimes et de symétrie, vitesse d’élocution et jeu minimal et précis de corps-marionnettes persévérant dans la maniaquerie de leur être : le cinéaste joue de telles coquetteries formelles mais sans pour autant s’en satisfaire, parce qu’elles savent heureusement autoriser des élans lyriques insoupçonnés. Les mondes dépeints avec un sens précis dans la minutie descriptive par Wes Anderson sont certes de tous petits mondes : école privée (Rushmore), maison familiale accueillant trois générations (The Royal Tenenbaums), sous-marin rigolo (The Life Aquatic with Steve Zissou), chambre d’hôtel puis train (Hôtel Chevalier et The Darjeeling Limited), champ agricole (Fantastic Mister Fox) et petite île de la Nouvelle-Angleterre (Moonrise Kingdom). Ces petits mondes abritent également un petit peuple (exemplairement ce sont les animaux de la campagne de Fantastic Mister Fox), certes quelconque vu d’ensemble (alors qu’il peut être passionnant dans le détail), mais pour lequel Wes Anderson développe suffisamment d’empathie pour déployer un effort diégétique dépassant le stade (fétichiste) de la description exhaustive afin de permettre à ces communautés habitant de ces mondes de connaître de profonds chamboulements qui peuvent même confiner à la reconfiguration révolutionnaire. Ne jamais quitter les personnages sans avoir consigné la transformation des relations affectives qui les attachent les uns aux autres : sans avoir changé de position (on retrouve souvent à la fin des films de Wes Anderson un dispositif de fermeture qui fait écho à leur dispositif d’ouverture respectif), les personnages auront pourtant changé de place parce que les places elles-mêmes auront été dynamisés au point d’avoir vu leur forme, contenu ou leur consistance être modifiés. D’un point de vue plus structural, on dira que la grille symbolique demeure dans sa globalité pour autant qu’elle propose la métamorphose générale des intersections déterminant la particularité des cases qu’elle contient. Si, par exemple, l’on retrouve à la fin la même course filmée au ralenti des trois frères attrapant in extremis le Darjeeling Limited au début du film (qui porte le nom d’un train indien aussi fictif que l’hôtel Chevalier du court-métrage introductif, le sous-marin de Steve Zissou et l’île des enfants amoureux de Moonrise Kingdom), la course ne signifie évidemment plus la même chose. La répétition (ou la reprise au sens kierkegaardien) de cette séquence l’affecte d’un sens nouveau : les trois frères ne courent plus après le train censé représenter la seconde chance accordée à une fratrie cabossée (à l’image des bandages du personnage suicidaire interprété par Owen Wilson), car ils sont devenus trois amis qui courent après le train d’une nouvelle aventure ne relevant plus de l’économie familiale mais du partage de l’amitié. Plus généralement, le caractère utopique des fictions imaginées par Wes Anderson ressortit d’un anti-familialisme plutôt libertaire. L’échappée belle hors des sentiers balisés de l’ordre familial déterminant un épuisement des individualités la composant, et au nom de la réappropriation utopique des liens affectifs est cette fiction que ne cesse pas de réinventer un cinéaste qui a su quant à lui s’arracher de sa culture (texane) d’origine, comme il demande aujourd’hui à ses personnages de faire de même afin d’impulser les élans de l’utopie susceptibles d’une reconfiguration des relations communautaires et, corrélativement, d’une redynamisation des subjectivités qu’elles structurent.
Rappeler que Wes Anderson est d’origine texane (il est né à Houston) paraît incongru pour autant qu’on identifie (et réduit) cet état des Etats-Unis à l’imaginaire raciste diversement incarné par George W. Bush, Chuck Norris, les Texas Rangers et les Minute Men. L’incongruité est renforcée par le monde de références culturelles dont s’est doté un réalisateur qui, depuis son premier long métrage Bottle Rocket (1996), semble avoir été envoûté à jamais par les « Swinging Sixties », comme s’il n’était jamais revenu du Londres de 1967 et du Paris de 1968 (qu’il n’a pourtant pas connus puisqu’il est né le 1er mai 1969). Sept longs-métrages plus tard (Rushmore en 1998, The Royal Tenenbaums en 2001, The Life Aquatic with Steve Zissou en 2003, The Darjeeling Limited précédé par le court-métrage Hôtel Chevalier en 2007, le film d’animation Fantastic Mister Fox d’après Roald Dahl en 2010 et désormais Moonrise Kingdom projeté en ouverture de la sélection officielle de la 65ème édition du Festival de Cannes) parachèvent un geste esthétique dont la griffe stylistique, dorénavant parfaitement établie, est immédiatement reconnaissable. Plans fixes et frontaux, raccords à 180°, travellings latéraux fonctionnant comme des coupes transversales, panoramiques rapides donnant l’impression d’un espace scénographique à l’image d’un cube tournant sur lui-même, ralentis lyriques et voluptueux, couleurs pop et acidulées, effets de rimes et de symétrie, vitesse d’élocution et jeu minimal et précis de corps-marionnettes persévérant dans la maniaquerie de leur être : le cinéaste joue de telles coquetteries formelles mais sans pour autant s’en satisfaire, parce qu’elles savent heureusement autoriser des élans lyriques insoupçonnés. Les mondes dépeints avec un sens précis dans la minutie descriptive par Wes Anderson sont certes de tous petits mondes : école privée (Rushmore), maison familiale accueillant trois générations (The Royal Tenenbaums), sous-marin rigolo (The Life Aquatic with Steve Zissou), chambre d’hôtel puis train (Hôtel Chevalier et The Darjeeling Limited), champ agricole (Fantastic Mister Fox) et petite île de la Nouvelle-Angleterre (Moonrise Kingdom). Ces petits mondes abritent également un petit peuple (exemplairement ce sont les animaux de la campagne de Fantastic Mister Fox), certes quelconque vu d’ensemble (alors qu’il peut être passionnant dans le détail), mais pour lequel Wes Anderson développe suffisamment d’empathie pour déployer un effort diégétique dépassant le stade (fétichiste) de la description exhaustive afin de permettre à ces communautés habitant de ces mondes de connaître de profonds chamboulements qui peuvent même confiner à la reconfiguration révolutionnaire. Ne jamais quitter les personnages sans avoir consigné la transformation des relations affectives qui les attachent les uns aux autres : sans avoir changé de position (on retrouve souvent à la fin des films de Wes Anderson un dispositif de fermeture qui fait écho à leur dispositif d’ouverture respectif), les personnages auront pourtant changé de place parce que les places elles-mêmes auront été dynamisés au point d’avoir vu leur forme, contenu ou leur consistance être modifiés. D’un point de vue plus structural, on dira que la grille symbolique demeure dans sa globalité pour autant qu’elle propose la métamorphose générale des intersections déterminant la particularité des cases qu’elle contient. Si, par exemple, l’on retrouve à la fin la même course filmée au ralenti des trois frères attrapant in extremis le Darjeeling Limited au début du film (qui porte le nom d’un train indien aussi fictif que l’hôtel Chevalier du court-métrage introductif, le sous-marin de Steve Zissou et l’île des enfants amoureux de Moonrise Kingdom), la course ne signifie évidemment plus la même chose. La répétition (ou la reprise au sens kierkegaardien) de cette séquence l’affecte d’un sens nouveau : les trois frères ne courent plus après le train censé représenter la seconde chance accordée à une fratrie cabossée (à l’image des bandages du personnage suicidaire interprété par Owen Wilson), car ils sont devenus trois amis qui courent après le train d’une nouvelle aventure ne relevant plus de l’économie familiale mais du partage de l’amitié. Plus généralement, le caractère utopique des fictions imaginées par Wes Anderson ressortit d’un anti-familialisme plutôt libertaire. L’échappée belle hors des sentiers balisés de l’ordre familial déterminant un épuisement des individualités la composant, et au nom de la réappropriation utopique des liens affectifs est cette fiction que ne cesse pas de réinventer un cinéaste qui a su quant à lui s’arracher de sa culture (texane) d’origine, comme il demande aujourd’hui à ses personnages de faire de même afin d’impulser les élans de l’utopie susceptibles d’une reconfiguration des relations communautaires et, corrélativement, d’une redynamisation des subjectivités qu’elles structurent. The Darjeeling Limited touchait à la limite du petit système efficacement mis en place par Wes Anderson (la bouleversante utopie des trois frères apprenant à devenir des amis était enveloppée dans les vapeurs sucrées et colorées d’une Inde moins documentaire qu’issue des fantasmes culturels et cinéphiliques du cinéaste – du film The River en 1948 de Jean Renoir à ceux de Satyajit Ray en passant par le souvenir de la période indienne de George Harrison des Beatles). Avec l’aventure représentée par Fantastic Mister Fox (à nouveau une histoire de voleurs dans la suite de l’inaugural Bottle Rocket), il s’est agi de proposer le repli tactique dans les studios (ici londoniens) afin de valoriser le caractère enfantin propre à son geste esthétique, ainsi que certains de ses aspects formels (la fixité des postures et la mécanique des mouvements) qui manifestaient la proximité structurale de ce projet cinématographique avec le cinéma d’animation. En même temps, ce repli induisait paradoxalement aussi le surenchérissement dans la redéfinition utopique et libertaire des liens communautaires au point que le dépassement des rapports familiaux s’épanouissait dans le cadre d’un rapport de force (aux limites du rapport de classe) entre les animaux des champs menacés de spoliation et d’expropriation (voire d’extermination pour ceux qui ne voulaient pas partir) et les fermiers capitalistes représentés par l’affreux trio Boggis, Bunce et Bean. Parmi les nombreuses chansons composant la bande originale de ce film (dominée par les Beach Boys, les Rolling Stones et Burl Ives), on remarquera deux citations des musiques de Georges Delerue composées à l’occasion des films de François Truffaut, Une petite île pour Les Deux anglaises et le continent (1971) et Le Grand choral pour La Nuit américaine (1973). Le premier des deux emprunts annonce de toute évidence Moonrise Kingdom qui propose de faire d’une île amérindienne (le film a été tourné sur l’île Prudence située dans la baie de Narragansett dans le Rhode Island) le lieu d’une utopie (Utopia de Thomas More inscrivait en 1516 son idéal communiste dans le territoire d’une île) déterminant pour les deux amoureux Suzy Bishop (Kara Hayward) et Sam Shakusky (Jared Gilman) un mouvement de déterritorialisation auquel en retour n’échappera pas la petite communauté portuaire dont ils représentent les rejetons malheureux. Les motifs insulaire et amérindien renforcent ici symboliquement l’élan libertaire des cœurs qui désirent s’arracher de leur morne quotidien (une famille détestée par la jeune fille, une famille d’adoption qui rejette le jeune homme sans pour autant profiter du cadre collectif offert par le scoutisme). Sauf que cet arrachement va entraîner (et déchaîner) un mouvement en profondeur changeant les coordonnées familiales et communautaires du lieu. C’est une lame de fond (une pluie diluvienne et orageuse devenant un ouragan donnant une inondation) qui est en fait provoquée par un amour adolescent (magnifique coup de foudre :
The Darjeeling Limited touchait à la limite du petit système efficacement mis en place par Wes Anderson (la bouleversante utopie des trois frères apprenant à devenir des amis était enveloppée dans les vapeurs sucrées et colorées d’une Inde moins documentaire qu’issue des fantasmes culturels et cinéphiliques du cinéaste – du film The River en 1948 de Jean Renoir à ceux de Satyajit Ray en passant par le souvenir de la période indienne de George Harrison des Beatles). Avec l’aventure représentée par Fantastic Mister Fox (à nouveau une histoire de voleurs dans la suite de l’inaugural Bottle Rocket), il s’est agi de proposer le repli tactique dans les studios (ici londoniens) afin de valoriser le caractère enfantin propre à son geste esthétique, ainsi que certains de ses aspects formels (la fixité des postures et la mécanique des mouvements) qui manifestaient la proximité structurale de ce projet cinématographique avec le cinéma d’animation. En même temps, ce repli induisait paradoxalement aussi le surenchérissement dans la redéfinition utopique et libertaire des liens communautaires au point que le dépassement des rapports familiaux s’épanouissait dans le cadre d’un rapport de force (aux limites du rapport de classe) entre les animaux des champs menacés de spoliation et d’expropriation (voire d’extermination pour ceux qui ne voulaient pas partir) et les fermiers capitalistes représentés par l’affreux trio Boggis, Bunce et Bean. Parmi les nombreuses chansons composant la bande originale de ce film (dominée par les Beach Boys, les Rolling Stones et Burl Ives), on remarquera deux citations des musiques de Georges Delerue composées à l’occasion des films de François Truffaut, Une petite île pour Les Deux anglaises et le continent (1971) et Le Grand choral pour La Nuit américaine (1973). Le premier des deux emprunts annonce de toute évidence Moonrise Kingdom qui propose de faire d’une île amérindienne (le film a été tourné sur l’île Prudence située dans la baie de Narragansett dans le Rhode Island) le lieu d’une utopie (Utopia de Thomas More inscrivait en 1516 son idéal communiste dans le territoire d’une île) déterminant pour les deux amoureux Suzy Bishop (Kara Hayward) et Sam Shakusky (Jared Gilman) un mouvement de déterritorialisation auquel en retour n’échappera pas la petite communauté portuaire dont ils représentent les rejetons malheureux. Les motifs insulaire et amérindien renforcent ici symboliquement l’élan libertaire des cœurs qui désirent s’arracher de leur morne quotidien (une famille détestée par la jeune fille, une famille d’adoption qui rejette le jeune homme sans pour autant profiter du cadre collectif offert par le scoutisme). Sauf que cet arrachement va entraîner (et déchaîner) un mouvement en profondeur changeant les coordonnées familiales et communautaires du lieu. C’est une lame de fond (une pluie diluvienne et orageuse devenant un ouragan donnant une inondation) qui est en fait provoquée par un amour adolescent (magnifique coup de foudre :  Il ne s’agit donc pas seulement de rappeler comment, dans Moonrise Kingdom, les formes de l’enfance peuvent être imprégnées du souvenir des spectacles de fin d’année scolaire (qui succèdent aux représentations théâtrales de Rushmore). Il ne s’agit pas, dans le seul flashback du film, de montrer quelques fragments de L’Arche de Noé (1957) de Benjamin Britten à partir desquels illustrer le coup de foudre entre Sam et Suzy. Il s’agira plutôt de faire que la seconde partie du film, attachée à rendre compte de l’effort obstiné des deux amoureux pour répéter une fugue qui déterminera un bouleversement général des positions individuelles et des relations collectives, rejoue dans le réel et avec un sens de l’accélération vertigineux l’épisode biblique de l’Arche de Noé, avec ses fugitifs camouflés dans des déguisements d’animaux (on songe alors immédiatement à Fantastic Mister Fox), ses torrents d’eau boueuse, son tonnerre fracassant et ses éclairs quasi-divins. Il s’agira de faire résonner, après la chanson Les Champs-Elysées de Joe Dassin dans The Darjeeling Limited, Le Temps de l’amour de Françoise Hardy (l’action du film se déroule en 1965) sur la platine portative posée à même le sable d’une plage sauvage qui rappelle explicitement les robinsonnades amoureuses de Badlands (1974) de Terrence Malick, Pierrot le fou de Jean-Luc Godard (tourné en 1965, l'année du récit) et de Monika (1952) d’Ingmar Bergman. Et il s’agira enfin de faire en conclusion du film avec la musique composée par Alexandre Desplat (il avait déjà écrite celle de Fantastic Mister Fox) la même chose que ce que The Young’s Person Guide To The Orchestra (1946) de Benjamin Britten avait fait avec le rondeau Abdelazer (1695) de Henry Purcell que l’on entend au début du même film, à savoir l’analyse commentée et pédagogique à destination d’un public enfantin des instruments utilisés pour le morceau. Les maisons de poupée chères au cinéma de Wes Anderson sont en fait des maisons-gigogne pouvant accueillir le dépliage des généalogies artistiques intensifiant l’arrachement sentimental de deux enfants (c’est ce magnifique travelling au ralenti après le mariage célébré par le cousin Ben) dont l’amour ébranle et refait littéralement le monde à l’image de leur amour. Il faudra donc rendre grâce à un cinéaste capable de filmer tout à la fois le sérieux des enfants qui, embarqués dans l’utopique construction de l’espace de leur amour (dont le nom sera au final celui-là même du film), ne simulent jamais les adultes quand ils ont décidé d’en assumer la puissance de contestation, l’effarement des adultes impuissants à comprendre la réalité de l’amour des enfants, et enfin leur bouleversement quand ils comprennent qu’ils sont obligés d’outrepasser leurs propres limites afin d’aider ce qu’ils ont fini par reconnaître comme étant le bien le plus précieux de leur communauté. Autrement dit, l’amour de Sam et de Suzy (dont la fugue peut en rappeler d’autres, de Black Jack en 1979 de Ken Loach à Melody de Warris Hussein en 1971 en passant aussi par le film Little Fugitive tourné en 1953 par Morris Engel et Ray Ashley : cf.
Il ne s’agit donc pas seulement de rappeler comment, dans Moonrise Kingdom, les formes de l’enfance peuvent être imprégnées du souvenir des spectacles de fin d’année scolaire (qui succèdent aux représentations théâtrales de Rushmore). Il ne s’agit pas, dans le seul flashback du film, de montrer quelques fragments de L’Arche de Noé (1957) de Benjamin Britten à partir desquels illustrer le coup de foudre entre Sam et Suzy. Il s’agira plutôt de faire que la seconde partie du film, attachée à rendre compte de l’effort obstiné des deux amoureux pour répéter une fugue qui déterminera un bouleversement général des positions individuelles et des relations collectives, rejoue dans le réel et avec un sens de l’accélération vertigineux l’épisode biblique de l’Arche de Noé, avec ses fugitifs camouflés dans des déguisements d’animaux (on songe alors immédiatement à Fantastic Mister Fox), ses torrents d’eau boueuse, son tonnerre fracassant et ses éclairs quasi-divins. Il s’agira de faire résonner, après la chanson Les Champs-Elysées de Joe Dassin dans The Darjeeling Limited, Le Temps de l’amour de Françoise Hardy (l’action du film se déroule en 1965) sur la platine portative posée à même le sable d’une plage sauvage qui rappelle explicitement les robinsonnades amoureuses de Badlands (1974) de Terrence Malick, Pierrot le fou de Jean-Luc Godard (tourné en 1965, l'année du récit) et de Monika (1952) d’Ingmar Bergman. Et il s’agira enfin de faire en conclusion du film avec la musique composée par Alexandre Desplat (il avait déjà écrite celle de Fantastic Mister Fox) la même chose que ce que The Young’s Person Guide To The Orchestra (1946) de Benjamin Britten avait fait avec le rondeau Abdelazer (1695) de Henry Purcell que l’on entend au début du même film, à savoir l’analyse commentée et pédagogique à destination d’un public enfantin des instruments utilisés pour le morceau. Les maisons de poupée chères au cinéma de Wes Anderson sont en fait des maisons-gigogne pouvant accueillir le dépliage des généalogies artistiques intensifiant l’arrachement sentimental de deux enfants (c’est ce magnifique travelling au ralenti après le mariage célébré par le cousin Ben) dont l’amour ébranle et refait littéralement le monde à l’image de leur amour. Il faudra donc rendre grâce à un cinéaste capable de filmer tout à la fois le sérieux des enfants qui, embarqués dans l’utopique construction de l’espace de leur amour (dont le nom sera au final celui-là même du film), ne simulent jamais les adultes quand ils ont décidé d’en assumer la puissance de contestation, l’effarement des adultes impuissants à comprendre la réalité de l’amour des enfants, et enfin leur bouleversement quand ils comprennent qu’ils sont obligés d’outrepasser leurs propres limites afin d’aider ce qu’ils ont fini par reconnaître comme étant le bien le plus précieux de leur communauté. Autrement dit, l’amour de Sam et de Suzy (dont la fugue peut en rappeler d’autres, de Black Jack en 1979 de Ken Loach à Melody de Warris Hussein en 1971 en passant aussi par le film Little Fugitive tourné en 1953 par Morris Engel et Ray Ashley : cf.  La cote de Jacques Audiard n'a pas cessé de croître à chaque film, au point de représenter aujourd'hui une valeur sûre pour l'industrie du cinéma français, à la croisée idéale du cinéma d'auteur post-« Nouvelle vague » et d'un cinéma commercial hexagonal fortement marqué par un tropisme outre-Atlantique. Avec les
La cote de Jacques Audiard n'a pas cessé de croître à chaque film, au point de représenter aujourd'hui une valeur sûre pour l'industrie du cinéma français, à la croisée idéale du cinéma d'auteur post-« Nouvelle vague » et d'un cinéma commercial hexagonal fortement marqué par un tropisme outre-Atlantique. Avec les De rouille et d'os
De rouille et d'os Enfin, le nouveau long-métrage de Jacques Audiard (adapté d'un recueil de nouvelles de l'écrivain canadien Craig Davidson) doit être pensé dans la perspective (psychanalytique) d'un récit dont l'organisation symbolique est déterminée par le partage hétérosexuel le plus consensuel (pour ne pas dire conservateur, si ce n'est réactionnaire) s'agissant des rôles masculin et féminin. Si Un prophète est, à la suite de Regarde les hommes tomber et dans une moindre mesure Un héros très discret, moins redevable du problématique scénario psychanalytique qui unit dans une même série logique Sur mes lèvres, De battre mon cœur s'est arrêté et désormais De rouille et d'os, c'est qu'il savait s'épargner le traitement de l'obligatoire et utilitaire compagnie des femmes afin d'affirmer un grand récit de formation brechtien au sein duquel les hommes se reproduisent entre eux, entre pères et fils d'adoption en l'absence donc de toute intermédiation féminine. Dès que la Femme (comme idée immuable ou essence inaltérable – soit l'« éternel féminin » de Goethe) revient chez Jacques Audiard, c'est alors pour assurer une fonction symbolique évidente : l'incarnation salvatrice du « Phallus » pour des hommes qui l'ont mais ne savent pas bien quoi en faire. Comme l'a dit Jacques Lacan à la suite de Sigmund Freud posant le phallus dans l'ordre de l'image (celle du pénis), la nature du phallus se révèle dans le manque de pénis de la mère (« La science et la vérité » in Écrits, éd. Seuil, 1966, p. 877) qui explique pourquoi la femme est en quête dans le corps de son partenaire (forcément masculin) du pénis comme « fétiche » puisque l'organe dont l'homme est dépositaire identifie la fonction signifiante (« La signification du phallus » in Écrits, opus cité, p. 694 – cf.
Enfin, le nouveau long-métrage de Jacques Audiard (adapté d'un recueil de nouvelles de l'écrivain canadien Craig Davidson) doit être pensé dans la perspective (psychanalytique) d'un récit dont l'organisation symbolique est déterminée par le partage hétérosexuel le plus consensuel (pour ne pas dire conservateur, si ce n'est réactionnaire) s'agissant des rôles masculin et féminin. Si Un prophète est, à la suite de Regarde les hommes tomber et dans une moindre mesure Un héros très discret, moins redevable du problématique scénario psychanalytique qui unit dans une même série logique Sur mes lèvres, De battre mon cœur s'est arrêté et désormais De rouille et d'os, c'est qu'il savait s'épargner le traitement de l'obligatoire et utilitaire compagnie des femmes afin d'affirmer un grand récit de formation brechtien au sein duquel les hommes se reproduisent entre eux, entre pères et fils d'adoption en l'absence donc de toute intermédiation féminine. Dès que la Femme (comme idée immuable ou essence inaltérable – soit l'« éternel féminin » de Goethe) revient chez Jacques Audiard, c'est alors pour assurer une fonction symbolique évidente : l'incarnation salvatrice du « Phallus » pour des hommes qui l'ont mais ne savent pas bien quoi en faire. Comme l'a dit Jacques Lacan à la suite de Sigmund Freud posant le phallus dans l'ordre de l'image (celle du pénis), la nature du phallus se révèle dans le manque de pénis de la mère (« La science et la vérité » in Écrits, éd. Seuil, 1966, p. 877) qui explique pourquoi la femme est en quête dans le corps de son partenaire (forcément masculin) du pénis comme « fétiche » puisque l'organe dont l'homme est dépositaire identifie la fonction signifiante (« La signification du phallus » in Écrits, opus cité, p. 694 – cf.  Un mot pour finir concernant le palmarès 2012. La présidence assurée cette année par Nanni Moretti (récipiendaire de la Palme d’or en 2001 pour La Chambre du fils et présent en compétition officielle l’année dernière pour Habemus Papam – cf.
Un mot pour finir concernant le palmarès 2012. La présidence assurée cette année par Nanni Moretti (récipiendaire de la Palme d’or en 2001 pour La Chambre du fils et présent en compétition officielle l’année dernière pour Habemus Papam – cf. 
 « La société des camarades, c'est le rêve révolutionnaire américain, auquel Whitman a puissamment contribué. Rêve déçu et trahi bien avant celui de la société soviétique » a écrit Gilles Deleuze dans Critique et clinique (éd. Minuit, coll. « Paradoxe », 1993, p. 80). Walt Whitman, et plus généralement les écrivains comme Ralph Emerson et Henry David Thoreau, partisans de ce mouvement littéraire et culturel (et même spirituel) que fut pendant la première moitié du 19ème siècle le transcendantalisme, n'auront jamais cessé de hanter le cinéma étasunien à partir du moment où celui-ci, pris du désir d'abandonner le conservatisme et l'immobilisme des studios, décide de se jeter avec « extra-vagance » (Henry David Thoreau) dans l'aventure du « Dehors » (« La camaraderie est cette variablilité, qui implique une rencontre avec le Dehors, un cheminement des âmes en plein air, sur la "grand-route" » (Gilles Deleuze, idem) l'autorisant à vagabonder sur les chemins buissonniers d'une autre Amérique encore inconnue. Ou, pour reprendre le titre de l'ouvrage du philosophe Stanley Cavell publié en 1989, d'« Une nouvelle Amérique encore inapprochable » (éd. de l’Éclat, 1991). Entre l'exemplaire original de Leaves of Grass de Walt Whitman (publié de manière anonyme pour la première fois en 1855) qui appartient à Francis Ford Coppola et que la conjointe de l'écrivain déclassé de son dernier film Twixt (2012) menace de vendre pour régler leurs dettes et la production sous la houlette de ce dernier (Francis Ford Coppola détient les droits du livre de Jack Kerouac depuis 1968) de l'adaptation par le cinéaste brésilien Walter Salles de On the Road que son auteur a écrit et réécrit entre 1948 et 1956 en pensant constamment à son vieux maître Walt Whitman, il y aurait donc là comme une odeur persistante de « feuilles d'herbes » dans le cinéma (moins hollywoodien que) étasunien qui, plus ou moins volatile et suspendue, s'est notamment manifestée depuis dix ans par la réalisation de quelques grands films : par exemple The Straight Story (1999) de David Lynch, The New World (2005) de Terrence Malick et Into the Wild (2007) de Sean Penn (dans lequel on apercevait déjà Kristen Stewart qui fait moins bien ici que ce que son compagnon de Twilight réussit à accomplir dans Cosmopolis de David Cronenberg). Le neuvième long-métrage de David Salles arrive-t-il à s'inscrire dans cette grande lignée esthétique pour laquelle l'utopie anarchiste des rencontres et des « amours virils et populaires » (comme l'aurait encore dit Gilles Deleuze) ou d'un communisme spontané et libertaire qui aurait dépassé les pesanteurs de la propriété lucrative (« Il faut baisser le coût de la vie » disent les héros en riant et se moquant du slogan économique du président Harry Truman) et les injonctions de l'économie patriarcale et domestique est défendue au nom du partage constituant des égaux synonyme de la « prise sur le tas » théorisée avant la révolution russe par le prince Piotr Kropotkine ? On the Road réussit-il, comme le livre dont il se veut l'écho cinématographique, à « chanter le corps électrique » (Walt Whitman) de ceux qui, comme Sal Paradise (Jack Kerouac) et Dean Moriarty (Neal Cassady, l'« ange de feu » ou encore le « glandeur mystique » et le « saint-truqueur » comme le qualifiait l'écrivain), et puis aussi Carlo Marx (Allen Ginsberg) et Old Bull Lee (William Burroughs), ont été possédés par cette « rage de vivre » qui, pour les deux premiers, les a fait traverser d'est en ouest la « grosse bosse », de New York à San Francisco, puis du nord au sud, de Denver à Mexico, toujours en quête inextinguible de ce Graal qu'aura été pour eux l'« extase » équivalent du « It » des jazzmen (promesse d'un éveil spirituel qui s'appelle dans le bouddhisme zen « satori ») ? Le film de Walter Salles est-il donc arrivé à faire avec la pellicule argentique ce que Jack Kerouac a réussi à faire avec le gros rouleau de papier de plus de 36 mètres de long nécessaire à la synthèse de ses notes disparates, à savoir la continuation de la route par d'autres moyens (soit un « ruban de rêve » pour reprendre la métaphore d'Orson Welles) ?
« La société des camarades, c'est le rêve révolutionnaire américain, auquel Whitman a puissamment contribué. Rêve déçu et trahi bien avant celui de la société soviétique » a écrit Gilles Deleuze dans Critique et clinique (éd. Minuit, coll. « Paradoxe », 1993, p. 80). Walt Whitman, et plus généralement les écrivains comme Ralph Emerson et Henry David Thoreau, partisans de ce mouvement littéraire et culturel (et même spirituel) que fut pendant la première moitié du 19ème siècle le transcendantalisme, n'auront jamais cessé de hanter le cinéma étasunien à partir du moment où celui-ci, pris du désir d'abandonner le conservatisme et l'immobilisme des studios, décide de se jeter avec « extra-vagance » (Henry David Thoreau) dans l'aventure du « Dehors » (« La camaraderie est cette variablilité, qui implique une rencontre avec le Dehors, un cheminement des âmes en plein air, sur la "grand-route" » (Gilles Deleuze, idem) l'autorisant à vagabonder sur les chemins buissonniers d'une autre Amérique encore inconnue. Ou, pour reprendre le titre de l'ouvrage du philosophe Stanley Cavell publié en 1989, d'« Une nouvelle Amérique encore inapprochable » (éd. de l’Éclat, 1991). Entre l'exemplaire original de Leaves of Grass de Walt Whitman (publié de manière anonyme pour la première fois en 1855) qui appartient à Francis Ford Coppola et que la conjointe de l'écrivain déclassé de son dernier film Twixt (2012) menace de vendre pour régler leurs dettes et la production sous la houlette de ce dernier (Francis Ford Coppola détient les droits du livre de Jack Kerouac depuis 1968) de l'adaptation par le cinéaste brésilien Walter Salles de On the Road que son auteur a écrit et réécrit entre 1948 et 1956 en pensant constamment à son vieux maître Walt Whitman, il y aurait donc là comme une odeur persistante de « feuilles d'herbes » dans le cinéma (moins hollywoodien que) étasunien qui, plus ou moins volatile et suspendue, s'est notamment manifestée depuis dix ans par la réalisation de quelques grands films : par exemple The Straight Story (1999) de David Lynch, The New World (2005) de Terrence Malick et Into the Wild (2007) de Sean Penn (dans lequel on apercevait déjà Kristen Stewart qui fait moins bien ici que ce que son compagnon de Twilight réussit à accomplir dans Cosmopolis de David Cronenberg). Le neuvième long-métrage de David Salles arrive-t-il à s'inscrire dans cette grande lignée esthétique pour laquelle l'utopie anarchiste des rencontres et des « amours virils et populaires » (comme l'aurait encore dit Gilles Deleuze) ou d'un communisme spontané et libertaire qui aurait dépassé les pesanteurs de la propriété lucrative (« Il faut baisser le coût de la vie » disent les héros en riant et se moquant du slogan économique du président Harry Truman) et les injonctions de l'économie patriarcale et domestique est défendue au nom du partage constituant des égaux synonyme de la « prise sur le tas » théorisée avant la révolution russe par le prince Piotr Kropotkine ? On the Road réussit-il, comme le livre dont il se veut l'écho cinématographique, à « chanter le corps électrique » (Walt Whitman) de ceux qui, comme Sal Paradise (Jack Kerouac) et Dean Moriarty (Neal Cassady, l'« ange de feu » ou encore le « glandeur mystique » et le « saint-truqueur » comme le qualifiait l'écrivain), et puis aussi Carlo Marx (Allen Ginsberg) et Old Bull Lee (William Burroughs), ont été possédés par cette « rage de vivre » qui, pour les deux premiers, les a fait traverser d'est en ouest la « grosse bosse », de New York à San Francisco, puis du nord au sud, de Denver à Mexico, toujours en quête inextinguible de ce Graal qu'aura été pour eux l'« extase » équivalent du « It » des jazzmen (promesse d'un éveil spirituel qui s'appelle dans le bouddhisme zen « satori ») ? Le film de Walter Salles est-il donc arrivé à faire avec la pellicule argentique ce que Jack Kerouac a réussi à faire avec le gros rouleau de papier de plus de 36 mètres de long nécessaire à la synthèse de ses notes disparates, à savoir la continuation de la route par d'autres moyens (soit un « ruban de rêve » pour reprendre la métaphore d'Orson Welles) ?  Lorsque Marylou, après avoir masturbé ses deux amants Dean Moriarty et Sal Paradise tous les trois nus dans la voiture qui fonce sur les routes poussiéreuses d'un avenir indistinct, feuillette quelques pages du premier volume de A la recherche du temps perdu de Marcel Proust, Du côté de chez Swann écrit en 1913 (c'est un peu la boussole littéraire des héros, avec Louis-Ferdinand Céline aussi, William Faulkner, Virginia Woolf et Arthur Schopenhauer également, et bien sûr toujours Walt Whitman), et qu'elle relève ensuite la tête pour apercevoir ses deux hommes pisser de concert en bordure du désert, On the Road prouve alors qu'il aurait pu parfaitement saisir la vérité esthétique ayant déterminé la création d'une œuvre comme celle qu'il a voulu adapter. La masturbation collective et la lecture individuelle, les plaisirs littéraires et les besoins physiologiques : soit toujours un même désir qui passe par le circuit hétérogène du sperme, des mots et de l'urine. C'est l'affirmation joyeuse de l'immanence, d'un seul et même « plan d'immanence » (Gilles Deleuze) sur lequel reposent conjointement et sans hiérarchisation, non plus verticalement mais horizontalement, les formes multiples de l'existence humaine. C'est l'exposition d'une seule et même substance (comme l'aurait dit le Spinoza de L’Éthique) dont l'« univocité » (Gilles Deleuze), autrement dit la même voix quelle que soit la diverse matière de ses expressions concrètes, en dit la puissance désirante. Comme l'explique aussi Jacques Rancière, « "Esthétique" est le mot qui dit le nœud singulier, malaisé à penser, qui s'est formé il y a deux siècles entre les sublimités de l'art et le bruit d'une pompe à eau, entre un timbre voilé de cordes et la promesse d'une humanité nouvelle » (in Malaise dans l'esthétique, éd. Galilée, 2004, p. 25). Et, d'après le philosophe, l'esthétique est synonyme de politique pour autant qu'elle induise et construise dans l'indiscernabilité des formes de l'art et des formes de la vie l'utopie concrète d'une vie non-séparée et non-hiérarchisée (opus cité, p. 31-63). Le problème du film de Walter Salles consiste alors en ce qu'il n'est pas en capacité de croire que cette identification entre esthétique et politique, pourtant au cœur du projet littéraire de Jack Kerouac, pourrait formellement configurer l’entièreté de son dispositif, au lieu de seulement se cantonner dans quelques trop rares niches ou interstices. En ce sens, le malaise dans l'esthétique analysé par Jacques Rancière n'aura pas été vraiment levé par le film de Walter Salles : « Le malaise et le ressentiment qu'il [le nœud singulier de l'esthétique] suscite aujourd'hui tournent toujours de fait autour de ces deux rapports : scandale d'un art qui accueille dans ses formes et dans ses lieux le "n'importe quoi" des objets d'usage et des images de la vie profane ; promesses exorbitantes et mensongères d'une révolution esthétique qui voulait transformer les formes de l'art en formes de vie nouvelle » (op. cit., p. 25).
Lorsque Marylou, après avoir masturbé ses deux amants Dean Moriarty et Sal Paradise tous les trois nus dans la voiture qui fonce sur les routes poussiéreuses d'un avenir indistinct, feuillette quelques pages du premier volume de A la recherche du temps perdu de Marcel Proust, Du côté de chez Swann écrit en 1913 (c'est un peu la boussole littéraire des héros, avec Louis-Ferdinand Céline aussi, William Faulkner, Virginia Woolf et Arthur Schopenhauer également, et bien sûr toujours Walt Whitman), et qu'elle relève ensuite la tête pour apercevoir ses deux hommes pisser de concert en bordure du désert, On the Road prouve alors qu'il aurait pu parfaitement saisir la vérité esthétique ayant déterminé la création d'une œuvre comme celle qu'il a voulu adapter. La masturbation collective et la lecture individuelle, les plaisirs littéraires et les besoins physiologiques : soit toujours un même désir qui passe par le circuit hétérogène du sperme, des mots et de l'urine. C'est l'affirmation joyeuse de l'immanence, d'un seul et même « plan d'immanence » (Gilles Deleuze) sur lequel reposent conjointement et sans hiérarchisation, non plus verticalement mais horizontalement, les formes multiples de l'existence humaine. C'est l'exposition d'une seule et même substance (comme l'aurait dit le Spinoza de L’Éthique) dont l'« univocité » (Gilles Deleuze), autrement dit la même voix quelle que soit la diverse matière de ses expressions concrètes, en dit la puissance désirante. Comme l'explique aussi Jacques Rancière, « "Esthétique" est le mot qui dit le nœud singulier, malaisé à penser, qui s'est formé il y a deux siècles entre les sublimités de l'art et le bruit d'une pompe à eau, entre un timbre voilé de cordes et la promesse d'une humanité nouvelle » (in Malaise dans l'esthétique, éd. Galilée, 2004, p. 25). Et, d'après le philosophe, l'esthétique est synonyme de politique pour autant qu'elle induise et construise dans l'indiscernabilité des formes de l'art et des formes de la vie l'utopie concrète d'une vie non-séparée et non-hiérarchisée (opus cité, p. 31-63). Le problème du film de Walter Salles consiste alors en ce qu'il n'est pas en capacité de croire que cette identification entre esthétique et politique, pourtant au cœur du projet littéraire de Jack Kerouac, pourrait formellement configurer l’entièreté de son dispositif, au lieu de seulement se cantonner dans quelques trop rares niches ou interstices. En ce sens, le malaise dans l'esthétique analysé par Jacques Rancière n'aura pas été vraiment levé par le film de Walter Salles : « Le malaise et le ressentiment qu'il [le nœud singulier de l'esthétique] suscite aujourd'hui tournent toujours de fait autour de ces deux rapports : scandale d'un art qui accueille dans ses formes et dans ses lieux le "n'importe quoi" des objets d'usage et des images de la vie profane ; promesses exorbitantes et mensongères d'une révolution esthétique qui voulait transformer les formes de l'art en formes de vie nouvelle » (op. cit., p. 25).  Certes, on compte à l'actif de Walter Salles plusieurs road-movies avec lesquels On the Road aurait pu entrer en résonance : Terre lointaine réalisé avec Daniela Thomas en 1995 et Carnets de voyage réalisé en 2003 d'après les journaux des amis Ernesto Guevara et Alberto Granado écrits après leur grand voyage en Amérique du sud en 1952. Certes, l'existence difficile des précaires et des vagabonds est au cœur des préoccupations d'autres films réalisés par le cinéaste brésilien, comme Central do Brasil en 1998 et Une famille brésilienne en 2008 réalisé à nouveau avec Daniela Thomas. Mais le remake tourné en 2005 au Québec du film fantastique japonais Dark Water (2002) de Hideo Nakata manifeste également, au vu de la très faible qualité esthétique du film, l'opportunisme de Walter Salles. Le casting « glamour » de son nouveau film (Sam Riley dans le rôle de Sal Paradise, Garrett Hedlund dans celui de Dean Moriarty, Kristen Stewart dans le rôle de Marylou, Kirsten Dunst dans celui de Camille et Viggo Mortensen dans le rôle de Old Bull Lee) est une autre preuve d'un souci d'intégration dans la clinquante vitrine internationale du cinéma dont le Festival de Cannes est aussi le relais privilégié. Certes, le choix de Viggo Mortensen témoigne d'une vraie intelligence, en ce sens que l'acteur fétiche des derniers films de David Cronenberg (A History of Violence en 2005, Eastern Promises en 2007, A Dangerous Method en 2011 – cf.
Certes, on compte à l'actif de Walter Salles plusieurs road-movies avec lesquels On the Road aurait pu entrer en résonance : Terre lointaine réalisé avec Daniela Thomas en 1995 et Carnets de voyage réalisé en 2003 d'après les journaux des amis Ernesto Guevara et Alberto Granado écrits après leur grand voyage en Amérique du sud en 1952. Certes, l'existence difficile des précaires et des vagabonds est au cœur des préoccupations d'autres films réalisés par le cinéaste brésilien, comme Central do Brasil en 1998 et Une famille brésilienne en 2008 réalisé à nouveau avec Daniela Thomas. Mais le remake tourné en 2005 au Québec du film fantastique japonais Dark Water (2002) de Hideo Nakata manifeste également, au vu de la très faible qualité esthétique du film, l'opportunisme de Walter Salles. Le casting « glamour » de son nouveau film (Sam Riley dans le rôle de Sal Paradise, Garrett Hedlund dans celui de Dean Moriarty, Kristen Stewart dans le rôle de Marylou, Kirsten Dunst dans celui de Camille et Viggo Mortensen dans le rôle de Old Bull Lee) est une autre preuve d'un souci d'intégration dans la clinquante vitrine internationale du cinéma dont le Festival de Cannes est aussi le relais privilégié. Certes, le choix de Viggo Mortensen témoigne d'une vraie intelligence, en ce sens que l'acteur fétiche des derniers films de David Cronenberg (A History of Violence en 2005, Eastern Promises en 2007, A Dangerous Method en 2011 – cf.  « Un spectre hante le monde : le spectre du capitalisme » : ce slogan obscur apparaît aux yeux du héros Eric Michael Packer (Robert Pattinson) sur un panneau lumineux en haut d'un building de New York, pendant que sa grande limousine blanche « proustée » (« prousted » dans le texte de Don DeLillo, autrement dit tapissée de liège à l'instar du cabinet d'écriture de Marcel Proust !) traverse les artères saturées de la « grosse pomme » en direction d'un salon de coiffure susceptible de satisfaire son bon plaisir du moment : une simple coupe de cheveux. Au-delà de toute ironie (l'homme est déjà parfaitement coiffé), on reconnaît dans cette formule le très sérieux renversement dialectique de la proposition principale du Manifeste du parti communiste rédigé en 1848 par Karl Marx et Friedrich Engels : « Un spectre hante l'Europe : le spectre du communisme ». Si Jacques Derrida a par exemple puissamment insisté sur les « spectres de Marx » et la récurrence du motif fantomatique dans l'œuvre du philosophe et militant communiste (in Spectres de Marx, éd. Galilée, 1993), le capitalisme est présentement envisagé dans une perspective spectrale pour autant que ce régime économique aurait définitivement accompli la subsomption, non plus formelle mais réelle, du capital sur le travail, et plus encore et plus radicalement, la subsomption du capital sur les formes de vie elles-mêmes (lire par exemple Toni Negri, Fabrique de porcelaine, éd. Stock, 2006). Cette subsomption qui détermine le fait que, pour parler comme Guy Debord au début de La Société du spectacle (éd. Denoël, 1967), la vie ne cesse de s'éloigner toujours plus loin dans les représentations d'une accumulation de marchandises devenue spectaculaire, justifie la décision du cinéaste canadien David Cronenberg de s'emparer, à l'occasion de son vingtième long-métrage produit par le génial portugais Paulo Branco (cf.
« Un spectre hante le monde : le spectre du capitalisme » : ce slogan obscur apparaît aux yeux du héros Eric Michael Packer (Robert Pattinson) sur un panneau lumineux en haut d'un building de New York, pendant que sa grande limousine blanche « proustée » (« prousted » dans le texte de Don DeLillo, autrement dit tapissée de liège à l'instar du cabinet d'écriture de Marcel Proust !) traverse les artères saturées de la « grosse pomme » en direction d'un salon de coiffure susceptible de satisfaire son bon plaisir du moment : une simple coupe de cheveux. Au-delà de toute ironie (l'homme est déjà parfaitement coiffé), on reconnaît dans cette formule le très sérieux renversement dialectique de la proposition principale du Manifeste du parti communiste rédigé en 1848 par Karl Marx et Friedrich Engels : « Un spectre hante l'Europe : le spectre du communisme ». Si Jacques Derrida a par exemple puissamment insisté sur les « spectres de Marx » et la récurrence du motif fantomatique dans l'œuvre du philosophe et militant communiste (in Spectres de Marx, éd. Galilée, 1993), le capitalisme est présentement envisagé dans une perspective spectrale pour autant que ce régime économique aurait définitivement accompli la subsomption, non plus formelle mais réelle, du capital sur le travail, et plus encore et plus radicalement, la subsomption du capital sur les formes de vie elles-mêmes (lire par exemple Toni Negri, Fabrique de porcelaine, éd. Stock, 2006). Cette subsomption qui détermine le fait que, pour parler comme Guy Debord au début de La Société du spectacle (éd. Denoël, 1967), la vie ne cesse de s'éloigner toujours plus loin dans les représentations d'une accumulation de marchandises devenue spectaculaire, justifie la décision du cinéaste canadien David Cronenberg de s'emparer, à l'occasion de son vingtième long-métrage produit par le génial portugais Paulo Branco (cf.  Le plaisir de l'adaptation mise en œuvre par David Cronenberg lui-même (et entreprise en six jours seulement) repose largement sur la reprise textuelle de pans entiers de dialogues dont l'aspect énigmatique ou cryptique est inséparable d'une drôlerie qui fait, au-delà de toute étrangeté, constamment mouche. Disserter sur des mécanismes financiers complexes lors d'une analyse rectale effectuée par un médecin intérimaire sur la personne d'Eric Packer dans sa limousine, ou bien s'émouvoir de la mort (même pas spectaculaire, même pas par balles, mais seulement et si pauvrement naturelle) du rappeur (soufi !) le plus à la mode dans le monde de la tolérance multiculturelle décrié par Slavoj Zizek, et dont la musique agrémente l'utilisation du second ascenseur privé du protagoniste (quand la musique d'Eric Satie accompagne l'usage de son premier ascenseur) : c'est dans tous les cas exposer la sensibilité particulière de l'homme qui, personnifiant le capitalisme à l'état quasiment pur, parle un langage dont la codification linguistique échappe aux profanes. Ceux-là mêmes qui, dans le monde infernal des prolétaires rejetés derrière les vitres fumées de sa limousine, en sont indistinctement les victimes anonymes (et le premier plan longeant les limousines ne rappelle-t-il pas celui qui ouvrait A History of Violence, induisant alors l'idée que les criminels d'hier ont désormais été remplacés par les délinquants en col blanc d'aujourd'hui ?). C'est aussi donner à comprendre l'existence livide et désaffectée, voire inconsistante, d'un individu qui concentre un si grand pouvoir entre ses mains (son siège est explicitement représenté comme un trône royal) qu'il peut l'autoriser à s'offrir les services d'une armada de techniciens (gardes du corps surentraînés et analystes avec lesquels il peut de temps en temps baiser quand sa conjointe légitime ne cesse quant à elle de glisser sur d'autres ondes fuyantes) qui se succèdent (de manière cut et avec différents types de focales régissant les champs-contrechamps afin de jouer organiquement sur les dimensions spatiales du véhicule) dans sa limousine de luxe sur le mode d'un zapping les arrachant ainsi à toute idée de continuité hors-champ. C'est enfin montrer la situation d'une incarnation particulière du rapport social capitaliste quand il atteint son plus haut niveau d'intensité d'abstraite, replié dans le dedans du cœur du capitalisme dont le dehors serait fait de la matière virtuelle d'une contestation fondue-enchaînée dans un devenir spectaculaire autant figuré par l'hommage public rendu au rappeur décédé que par l'attentat pâtissier dont est victime le héros (et pendant ce temps, les mouvements du président des États-Unis demeurent hors-champ, relégués dans les marges d'un pouvoir dès lors passé du politique à l'économique). Sauf que si Cosmopolis identifiait son récit à ce constat sans se ménager des marges de manœuvre et d'intervention interstitielle, il s'abandonnerait aux plaisirs du fétichisme et du « capitalisme de la séduction » (Michel Clouscard) dont il est censé se distancier. Heureusement, le film ne succombe pas à cette pente fataliste et nihiliste (autrement dit apolitique) qui menace également le roman éponyme de Don DeLillo et pour laquelle l'horreur serait moins politique qu'économique (comme l'affirmaient typiquement Viviane Forrester dans L'Horreur économique en 1996 ou De la servitude moderne de Jean-François Brient en 2009 : cf.
Le plaisir de l'adaptation mise en œuvre par David Cronenberg lui-même (et entreprise en six jours seulement) repose largement sur la reprise textuelle de pans entiers de dialogues dont l'aspect énigmatique ou cryptique est inséparable d'une drôlerie qui fait, au-delà de toute étrangeté, constamment mouche. Disserter sur des mécanismes financiers complexes lors d'une analyse rectale effectuée par un médecin intérimaire sur la personne d'Eric Packer dans sa limousine, ou bien s'émouvoir de la mort (même pas spectaculaire, même pas par balles, mais seulement et si pauvrement naturelle) du rappeur (soufi !) le plus à la mode dans le monde de la tolérance multiculturelle décrié par Slavoj Zizek, et dont la musique agrémente l'utilisation du second ascenseur privé du protagoniste (quand la musique d'Eric Satie accompagne l'usage de son premier ascenseur) : c'est dans tous les cas exposer la sensibilité particulière de l'homme qui, personnifiant le capitalisme à l'état quasiment pur, parle un langage dont la codification linguistique échappe aux profanes. Ceux-là mêmes qui, dans le monde infernal des prolétaires rejetés derrière les vitres fumées de sa limousine, en sont indistinctement les victimes anonymes (et le premier plan longeant les limousines ne rappelle-t-il pas celui qui ouvrait A History of Violence, induisant alors l'idée que les criminels d'hier ont désormais été remplacés par les délinquants en col blanc d'aujourd'hui ?). C'est aussi donner à comprendre l'existence livide et désaffectée, voire inconsistante, d'un individu qui concentre un si grand pouvoir entre ses mains (son siège est explicitement représenté comme un trône royal) qu'il peut l'autoriser à s'offrir les services d'une armada de techniciens (gardes du corps surentraînés et analystes avec lesquels il peut de temps en temps baiser quand sa conjointe légitime ne cesse quant à elle de glisser sur d'autres ondes fuyantes) qui se succèdent (de manière cut et avec différents types de focales régissant les champs-contrechamps afin de jouer organiquement sur les dimensions spatiales du véhicule) dans sa limousine de luxe sur le mode d'un zapping les arrachant ainsi à toute idée de continuité hors-champ. C'est enfin montrer la situation d'une incarnation particulière du rapport social capitaliste quand il atteint son plus haut niveau d'intensité d'abstraite, replié dans le dedans du cœur du capitalisme dont le dehors serait fait de la matière virtuelle d'une contestation fondue-enchaînée dans un devenir spectaculaire autant figuré par l'hommage public rendu au rappeur décédé que par l'attentat pâtissier dont est victime le héros (et pendant ce temps, les mouvements du président des États-Unis demeurent hors-champ, relégués dans les marges d'un pouvoir dès lors passé du politique à l'économique). Sauf que si Cosmopolis identifiait son récit à ce constat sans se ménager des marges de manœuvre et d'intervention interstitielle, il s'abandonnerait aux plaisirs du fétichisme et du « capitalisme de la séduction » (Michel Clouscard) dont il est censé se distancier. Heureusement, le film ne succombe pas à cette pente fataliste et nihiliste (autrement dit apolitique) qui menace également le roman éponyme de Don DeLillo et pour laquelle l'horreur serait moins politique qu'économique (comme l'affirmaient typiquement Viviane Forrester dans L'Horreur économique en 1996 ou De la servitude moderne de Jean-François Brient en 2009 : cf.  Le premier court-circuit entre le dedans et le dehors est d'abord symbolique : le rapport entre le toucher rectal subi par le protagoniste et la récurrence des rats (agités dans les cafés et dans les manifestations par des anarchistes qui ont peut-être alors compris la force imaginaire des symboles quand ils fonctionnent en tant que l'exposition de symptômes révélateurs de toutes les espèces du déni capitalistique) se comprend d'ailleurs d'autant mieux qu'il appelle la mise en regard du nouveau film du cinéaste avec son précédent long-métrage, A Dangerous Method (on peut d'ailleurs apercevoir une affiche du film près du salon de coiffure où le héros se fait à moitié couper les cheveux). Ce film qui raconte l'énergie émotionnelle alimentant les démarches théoriques respectives de Sigmund Freud, Carl Theodor Jung, Otto Gross et Sabina Spielrein, ainsi que les métamorphoses conceptuelles résultant de leurs relations affectives et de leurs confrontations professionnelles autorise le rappel de la célèbre analyse freudienne de L'homme aux rats. Un cas de névrose obsessionnelle, l'un des cinq cas cliniques du recueil Cinq psychanalyses paru en 1909. Ce cas psychanalytique expose notamment l'identification symptomatique entre la dette financière (« Rate », soit acompte en allemand) d'Ernst Lanzer et l'image qui l'obsède de la torture chinoise selon laquelle des rats (« Ratte » en allemand) s'introduisent dans l'anus d'un prisonnier pour y creuser des galeries (torture évoquée dans Le Jardin des supplices d'Octave Mirbeau en 1899). Les conversations amusées d'Eric Packer et de son jeune analyste financier Shiner (Jay Baruchel) concernant le rat comme unité d'échange économique mondial (comme « équivalentgénéral abstrait » aurait dit Karl Marx) doivent dès lors se comprendre en relation dynamique avec les diverses souillures qui, tantôt se déposent sur sa limousine, tantôt obligent le héros, après avoir progressivement abandonné ses lunettes, sa cravate et sa veste, à recevoir de la tarte au citron sur le visage et la chemise. L'identité, structurale sur le plan symbolique, entre le capital et l'anal, entre l'argent et l'excrément (cf.
Le premier court-circuit entre le dedans et le dehors est d'abord symbolique : le rapport entre le toucher rectal subi par le protagoniste et la récurrence des rats (agités dans les cafés et dans les manifestations par des anarchistes qui ont peut-être alors compris la force imaginaire des symboles quand ils fonctionnent en tant que l'exposition de symptômes révélateurs de toutes les espèces du déni capitalistique) se comprend d'ailleurs d'autant mieux qu'il appelle la mise en regard du nouveau film du cinéaste avec son précédent long-métrage, A Dangerous Method (on peut d'ailleurs apercevoir une affiche du film près du salon de coiffure où le héros se fait à moitié couper les cheveux). Ce film qui raconte l'énergie émotionnelle alimentant les démarches théoriques respectives de Sigmund Freud, Carl Theodor Jung, Otto Gross et Sabina Spielrein, ainsi que les métamorphoses conceptuelles résultant de leurs relations affectives et de leurs confrontations professionnelles autorise le rappel de la célèbre analyse freudienne de L'homme aux rats. Un cas de névrose obsessionnelle, l'un des cinq cas cliniques du recueil Cinq psychanalyses paru en 1909. Ce cas psychanalytique expose notamment l'identification symptomatique entre la dette financière (« Rate », soit acompte en allemand) d'Ernst Lanzer et l'image qui l'obsède de la torture chinoise selon laquelle des rats (« Ratte » en allemand) s'introduisent dans l'anus d'un prisonnier pour y creuser des galeries (torture évoquée dans Le Jardin des supplices d'Octave Mirbeau en 1899). Les conversations amusées d'Eric Packer et de son jeune analyste financier Shiner (Jay Baruchel) concernant le rat comme unité d'échange économique mondial (comme « équivalentgénéral abstrait » aurait dit Karl Marx) doivent dès lors se comprendre en relation dynamique avec les diverses souillures qui, tantôt se déposent sur sa limousine, tantôt obligent le héros, après avoir progressivement abandonné ses lunettes, sa cravate et sa veste, à recevoir de la tarte au citron sur le visage et la chemise. L'identité, structurale sur le plan symbolique, entre le capital et l'anal, entre l'argent et l'excrément (cf.  A la différence de Louise-Michel (2008) de Gustave Kervern et Benoît Delépine qui racontait comment des prolétaires devaient amorcer un grand voyage avant de pouvoir retrouver et flinguer les représentants du pouvoir patronal qui les avaient dépossédés de leur travail, Cosmopolis raconte exactement l'inverse. Soit comment un capitaliste sort de sa limousine et traverse les farandoles de la contestation simulée pour aller à la rencontre du réel sous la forme du prolétaire qu'il a licencié et qui veut se venger de lui en se'en prenant à sa vie. Ce qui est infiniment plus subversif, parce que le réel des contradictions des rapports entre le capital et le travail est ce vers quoi vont, quoi qu'ils en disent et quel que soit le degré d'abstraction imposé dans les consciences par le fétichisme de l'accumulation financière du capital (degré d'abstraction tel qu'il se prolonge également à l'occasion des génériques de début et de fin du film, respectivement inspirés par le dripping de Jackson Pollock et les à-plats de Mark Rothko), les représentants des intérêts du capital lui-même. Ce mouvement réellement en train de s'accomplir est très précisément ce que Friedrich Engels et Karl Marx nommait dans L'Idéologie allemande en 1845 le « communisme ». Certes, dira-t-on, la fin est suspendue, l'exécution comme figée sur le visage d'Eric Packer derrière qui se tient son bourreau armé. Au spectateur alors d'accomplir le programme de la sortie du capitalisme, en imaginant la suite (et la fin) d'un récit allégorique qui aura su insister sur l'impossibilité d'échapper au règlement des contradictions en régime économique capitaliste.
A la différence de Louise-Michel (2008) de Gustave Kervern et Benoît Delépine qui racontait comment des prolétaires devaient amorcer un grand voyage avant de pouvoir retrouver et flinguer les représentants du pouvoir patronal qui les avaient dépossédés de leur travail, Cosmopolis raconte exactement l'inverse. Soit comment un capitaliste sort de sa limousine et traverse les farandoles de la contestation simulée pour aller à la rencontre du réel sous la forme du prolétaire qu'il a licencié et qui veut se venger de lui en se'en prenant à sa vie. Ce qui est infiniment plus subversif, parce que le réel des contradictions des rapports entre le capital et le travail est ce vers quoi vont, quoi qu'ils en disent et quel que soit le degré d'abstraction imposé dans les consciences par le fétichisme de l'accumulation financière du capital (degré d'abstraction tel qu'il se prolonge également à l'occasion des génériques de début et de fin du film, respectivement inspirés par le dripping de Jackson Pollock et les à-plats de Mark Rothko), les représentants des intérêts du capital lui-même. Ce mouvement réellement en train de s'accomplir est très précisément ce que Friedrich Engels et Karl Marx nommait dans L'Idéologie allemande en 1845 le « communisme ». Certes, dira-t-on, la fin est suspendue, l'exécution comme figée sur le visage d'Eric Packer derrière qui se tient son bourreau armé. Au spectateur alors d'accomplir le programme de la sortie du capitalisme, en imaginant la suite (et la fin) d'un récit allégorique qui aura su insister sur l'impossibilité d'échapper au règlement des contradictions en régime économique capitaliste. 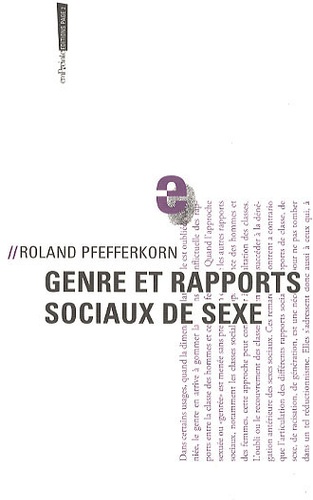
 Pourquoi le nouvel ouvrage de notre camarade Alain Bihr publié dans la collection « Empreinte » des éditions Page 2 s'appelle-t-il
Pourquoi le nouvel ouvrage de notre camarade Alain Bihr publié dans la collection « Empreinte » des éditions Page 2 s'appelle-t-il