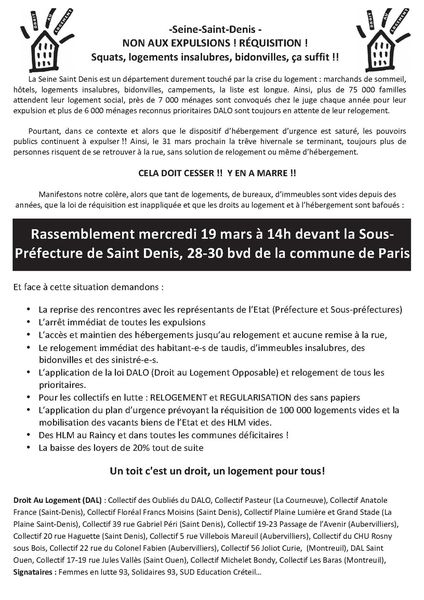Un film qu'il vous faudrait avoir vu pour qu'il vous regarde en vous montrant que ce que vous croyez de l'Algérie n'est pas commensurable avec l'inépuisable territoire que désigne ce nom. Un film à chaque fois raté, croisé une première fois au Festival Entrevues de Belfort en décembre 2013, puis une seconde fois aux Rencontres internationales des cinémas arabes de Marseille en avril dernier, avant de pouvoir enfin nous autoriser à ce que l'on puisse en face de lui fixer quelques idées à la suite d'une projection en présence des réalisateurs du film, samedi 10 mai dernier, au cinéma L'Ecran de Saint-Denis dans le cadre du Panorama des cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient.
Chantier A (2013) de Tarek Sami, Lucie Dèche et Karim Loualiche
L'inépuisable et l'épuisé
« Les images, comme ces oisillons, servent aussi à cela : à voir le temps qui vient. A démonter le présent en remontant vers le passé, en remontant le passé, en délivrant de là quelque indice pour le futur. Elles servent aussi à remonter le présent et ''voir venir l'avenir'' à travers un certain passé, de manière que chacune des trois temporalités éclaire – souligne, ponctue, critique, délivre – les deux autres »
(Georges Didi-Huberman, Sentir le grisou, éd. Minuit, 2014, p. 26-27)
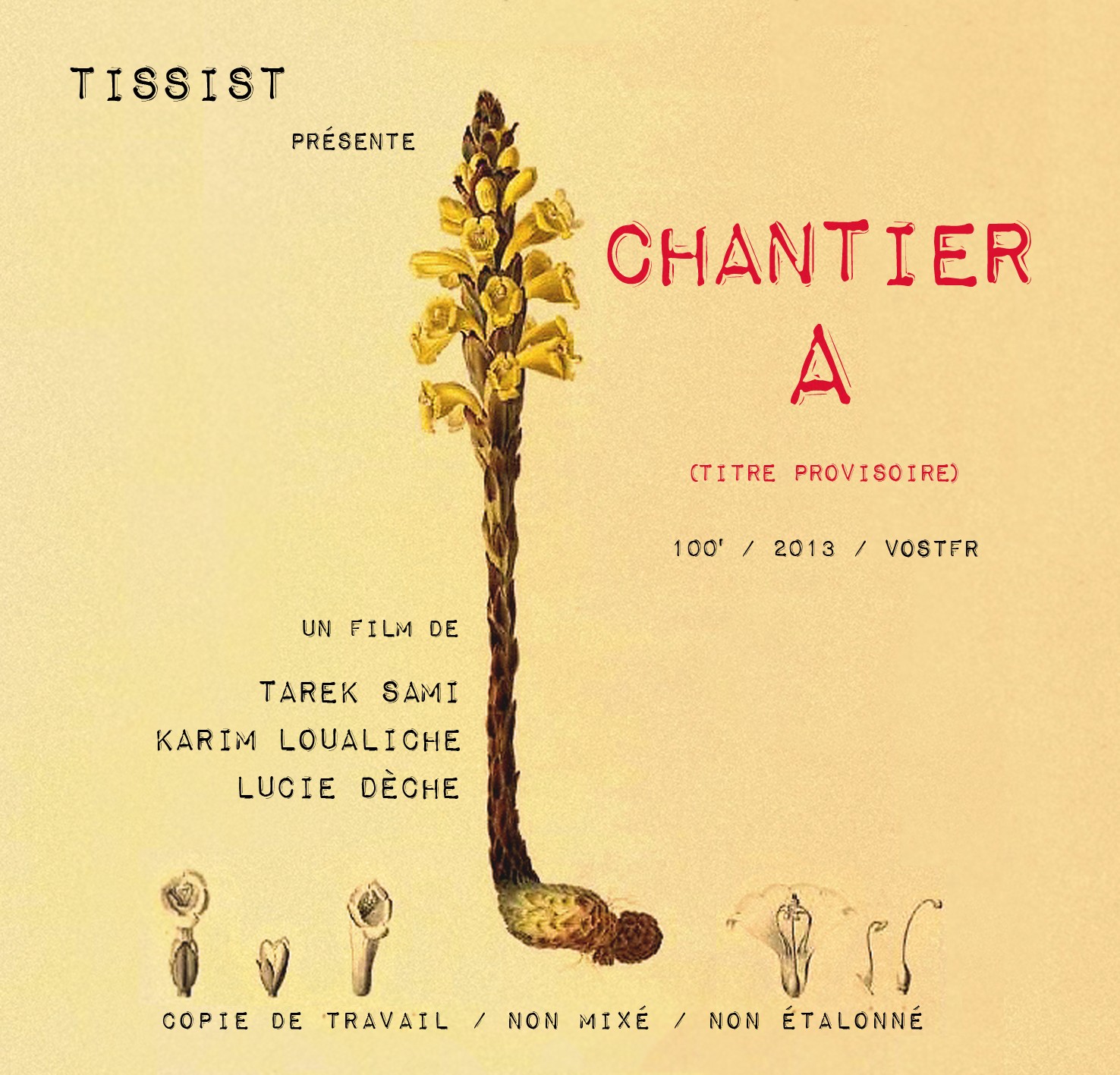 « Voir venir l'avenir » : il faudra bien arriver au terme du chemin ouvertement accidenté qu'arpente Chantier A pour voir, au bout du compte, que vient vers soi l'impossible. Un chemin non pas emprunté à partir de ceux qui, balisés, existeraient déjà mais un chemin tracé pied à pied par ceux-là qui se sont mis en tête d'auto-produire leur film puis se sont mis en marche afin d'en dénicher les images, pas à pas. Un chemin pour voir l'avenir que Chantier A aura vu venir, au-delà même de ce que ses auteurs y auront mis ou vu, déployant sans intentionnalité aucune une temporalité chiasmatique qui, faisant jouer entre eux le passé et le futur afin de les croiser, serait celle, exemplairement, du futur antérieur. C'est qu'un film, un bon, sait voir le temps qui vient depuis le temps qui passe, il sait voir venir un avenir que ne peuvent prévoir, voire oser imaginer, ses auteurs qui auront cheminé là où leurs pas les auront emmenés dans l'imprévisible destination d'une marche ayant depuis fait son chemin dans la tête du spectateur. La mise en marche du film pourrait logiquement s'identifier à son ouverture, la première chose filmée par la triade des réalisateurs, un enterrement à flanc de colline sous une pluie fine dont quelques gouttelettes mouillent l'objectif de la caméra. La cérémonie funéraire sous les auspices desquels se place terriblement ce premier long-métrage est celui du grand-père de l'un de ses trois auteurs, Karim Loualiche, un garçon d'une trentaine d'années qui, parti en France depuis dix ans, n'était pas retourné depuis dans le village kabyle de ses parents. Avant d'être accueilli dans les larmes pudiques de sa mère et de sa sœur comme dans un western de John Ford, Karim aura traversé de nuit une plaine dont le crissement sous ses pieds du marcheur atteste qu'elle est recouverte de neige. Dans le dernier plan de Chantier A, la blancheur de la neige viendra occuper tout l'écran recoupant la plaine traversée depuis le fond du plan par ce dernier, arrivant du blanc pour en repartir – à moins qu'il ne s'y fond, allégoriquement. Entre-temps, s'énonce comme un gag la vérité du contretemps caractérisant la situation existentielle de Karim : arrivé en retard pour l'enterrement du grand-père, il est aussi arrivé trop tôt pour la mise en terre de sa grand-mère qui sait témoigner malgré son âge avancé d'une belle vitalité. Trop tôt, trop tard : entre deux morts – l'une déjà réelle et l'autre seulement possible ; comme entre deux temps – la mémoire d'hier et la considération de ce qu'hier ressemble de moins en moins à aujourd'hui. Ce contretemps déterminerait autant l'impulsion au nom de laquelle Karim décide alors de se remettre en marche en quittant le village familial, accumulant le long de chemins qui n'existaient pas avant qu'il ne les invente des perceptions promises à devenir des souvenirs et à soutenir des images susceptibles de redessiner la carte algérienne au-delà de ses délimitations nationales-étatiques, que la puissance rétrospective d'un film finalisé depuis l'impossible décès par crise cardiaque de ce dernier à l'âge de 36 ans. Les images, à l'instar des oisillons utilisés par les mineurs afin de les prévenir de toute trace de ce gaz hautement inflammable qu'ils appellèrent le grisou, disposeraient donc dans une métaphore employée par Georges Didi-Huberman de ces « plumages divinatoires » (idem) dont le frémissement se ferait sentir, rétrospectivement, avec l'ouverture de Chantier A lorsque la conjonction du chant funéraire et la grisaille pluvieuse semblent idéalement se matérialiser dans ces gouttes ponctuant l'objectif qui sont alors comme des larmes essuyées par le chef opérateur de cette scène inaugurale, sans qu'on ne puisse savoir si se trouve derrière la caméra Karim Loualiche ou Tarek Sami (Lucie Dèche s'occupant pour sa part de la prise de son). Le caractère indiscernable de la figure du filmeur exposerait ainsi une déhiscence structurale dans la représentation qui, sans se réduire à la perspective réflexive selon laquelle Karim en tant qu'il est l'objet et le sujet de son documentaire est à la fois lui-même et un autre (autrement dit un personnage et de documentaire et de fiction), vérifierait autrement l'essentiel motif du contretemps. Contretemps par le biais duquel les auteurs dans la marche d'un film en train d'être tourné mais pas encore réalisé ainsi que les premiers spectateurs du film plus tard réalisé ne peuvent encore soutenir (ils ne le pourront dès lors que rétrospectivement) l'idée qu'il aura vu venir l'avenir de la mort imprévisible de l'un d'entre eux.
« Voir venir l'avenir » : il faudra bien arriver au terme du chemin ouvertement accidenté qu'arpente Chantier A pour voir, au bout du compte, que vient vers soi l'impossible. Un chemin non pas emprunté à partir de ceux qui, balisés, existeraient déjà mais un chemin tracé pied à pied par ceux-là qui se sont mis en tête d'auto-produire leur film puis se sont mis en marche afin d'en dénicher les images, pas à pas. Un chemin pour voir l'avenir que Chantier A aura vu venir, au-delà même de ce que ses auteurs y auront mis ou vu, déployant sans intentionnalité aucune une temporalité chiasmatique qui, faisant jouer entre eux le passé et le futur afin de les croiser, serait celle, exemplairement, du futur antérieur. C'est qu'un film, un bon, sait voir le temps qui vient depuis le temps qui passe, il sait voir venir un avenir que ne peuvent prévoir, voire oser imaginer, ses auteurs qui auront cheminé là où leurs pas les auront emmenés dans l'imprévisible destination d'une marche ayant depuis fait son chemin dans la tête du spectateur. La mise en marche du film pourrait logiquement s'identifier à son ouverture, la première chose filmée par la triade des réalisateurs, un enterrement à flanc de colline sous une pluie fine dont quelques gouttelettes mouillent l'objectif de la caméra. La cérémonie funéraire sous les auspices desquels se place terriblement ce premier long-métrage est celui du grand-père de l'un de ses trois auteurs, Karim Loualiche, un garçon d'une trentaine d'années qui, parti en France depuis dix ans, n'était pas retourné depuis dans le village kabyle de ses parents. Avant d'être accueilli dans les larmes pudiques de sa mère et de sa sœur comme dans un western de John Ford, Karim aura traversé de nuit une plaine dont le crissement sous ses pieds du marcheur atteste qu'elle est recouverte de neige. Dans le dernier plan de Chantier A, la blancheur de la neige viendra occuper tout l'écran recoupant la plaine traversée depuis le fond du plan par ce dernier, arrivant du blanc pour en repartir – à moins qu'il ne s'y fond, allégoriquement. Entre-temps, s'énonce comme un gag la vérité du contretemps caractérisant la situation existentielle de Karim : arrivé en retard pour l'enterrement du grand-père, il est aussi arrivé trop tôt pour la mise en terre de sa grand-mère qui sait témoigner malgré son âge avancé d'une belle vitalité. Trop tôt, trop tard : entre deux morts – l'une déjà réelle et l'autre seulement possible ; comme entre deux temps – la mémoire d'hier et la considération de ce qu'hier ressemble de moins en moins à aujourd'hui. Ce contretemps déterminerait autant l'impulsion au nom de laquelle Karim décide alors de se remettre en marche en quittant le village familial, accumulant le long de chemins qui n'existaient pas avant qu'il ne les invente des perceptions promises à devenir des souvenirs et à soutenir des images susceptibles de redessiner la carte algérienne au-delà de ses délimitations nationales-étatiques, que la puissance rétrospective d'un film finalisé depuis l'impossible décès par crise cardiaque de ce dernier à l'âge de 36 ans. Les images, à l'instar des oisillons utilisés par les mineurs afin de les prévenir de toute trace de ce gaz hautement inflammable qu'ils appellèrent le grisou, disposeraient donc dans une métaphore employée par Georges Didi-Huberman de ces « plumages divinatoires » (idem) dont le frémissement se ferait sentir, rétrospectivement, avec l'ouverture de Chantier A lorsque la conjonction du chant funéraire et la grisaille pluvieuse semblent idéalement se matérialiser dans ces gouttes ponctuant l'objectif qui sont alors comme des larmes essuyées par le chef opérateur de cette scène inaugurale, sans qu'on ne puisse savoir si se trouve derrière la caméra Karim Loualiche ou Tarek Sami (Lucie Dèche s'occupant pour sa part de la prise de son). Le caractère indiscernable de la figure du filmeur exposerait ainsi une déhiscence structurale dans la représentation qui, sans se réduire à la perspective réflexive selon laquelle Karim en tant qu'il est l'objet et le sujet de son documentaire est à la fois lui-même et un autre (autrement dit un personnage et de documentaire et de fiction), vérifierait autrement l'essentiel motif du contretemps. Contretemps par le biais duquel les auteurs dans la marche d'un film en train d'être tourné mais pas encore réalisé ainsi que les premiers spectateurs du film plus tard réalisé ne peuvent encore soutenir (ils ne le pourront dès lors que rétrospectivement) l'idée qu'il aura vu venir l'avenir de la mort imprévisible de l'un d'entre eux.
« Faire du cinéma écrivait Pier Paolo Pasolini, c'est écrire sur du papier qui brûle » (cité par Georges Didi-Huberman, opus cité, p. 90). Ce papier qui brûle, c'est aussi l'écran blanc comme neige sur lequel sont projetées les images témoignant présentement d'un passé qui aura vu venir l'avenir (et ce témoignage au présent d'un passé ayant vu l'avenir avère par conséquent la perspective temporelle du futur antérieur). Dit autrement, et de manière canonique, c'est la fameuse « mort au travail » définie par Jean Cocteau. S'il n'y a rien de plus contingent que la mort tombant sans qu'on y prenne garde, fondant sur nos têtes ou bien contrariant nos pas par mégarde et sans calcul, sa frappe assure aussi d'une nécessité obligeant à reconsidérer (et cette considération induit une pensée du montage comme remontage de la vie depuis son interruption subite par la mort subie) toute une trajectoire de vie. Depuis elle. Là encore, il est impossible de ne pas penser à nouveau à Pier Paolo Pasolini, d'une part quand il évoque la mort comme synthèse et montage de toute une existence et d'autre part quand il insiste sur ce qui reste et résiste d'une existence mortellement interrompue. « Le cinéma serait donc survivance –''le cinéma en pratique est comme une vie après la mort'' (il cinema in pratica è come una vita dopo la morte), écrit Pasolini en citant presque textuellement des formules célèbres qui, de l'Antiquité à la Renaissance, auront eu cours à propos de la peinture – dans la mesure où il se fait poème, c'est-à-dire une certaine façon de penser le montage comme art de rimes, conflits ou d'attractions rythmiquement déclinées. Comme un art de la pensée qui se situerait par-delà toute doctrine, un art de la politique qui se situerait par-delà tout mot d'ordre, un art de l'histoire qui se situerait par-delà toute stricte chronologie » (Georges Didi-Huberman, op. cit., p. 92-93). La survivance désigne alors ce qui, dans le travail de la mort imperceptiblement enregistrée par Chantier A et que n'auront pas vu venir les deux auteurs qui ont dû depuis apprendre à lui survivre, résiste à la mort. Si le contretemps manifeste la défaillance des temps et, dans le faux-raccord de leur articulation, l'intrusion interruptive de la mort, la survivance atteste de la résistance depuis les discordances mortelles du temps de la vie dès lors envisagée comme persévérance. Alors que le contretemps vérifie enfin l'impossibilité du retour pour celui qui, revenant après dix d'absence au pays natal, ne peut que constater que le temps a passé, la survivance affirme de son côté que ce qui persévère dans ce qui change mérite que l'on aille y voir d'un peu plus près, quitte à s'y abandonner. Deux images comme deux métaphores dont la fraternité (dirait Jean-Luc Godard) ou l'hospitalité (dirait plutôt Marie-José Mondzain) ou l'amitié (ainsi que nous préférons le dire) ferait le sel d'un tel geste de cinéma : c'est, d'une part, l'énorme pierre patiemment entreprise par un gars du coin afin d'être cassée en deux et c'est, d'autre part, la mention faite par la grand-mère des routes fermées alors que précisément le film s'échine à les ouvrir, quitte à ce que leur ouverture se fasse en marchant, pas après pas.
Il faut dire ici que tout Chantier A, qui commencerait sous les auspices de John Ford pour se poursuivre sur les brisées de Michelangelo Antonioni, est construit sur le mode d'une longue dérivation pavée d'épiphanies sédimentées (ou de cristaux d'intensité comme l'aurait dit Virginia Woolf), chaque séquence se posant comme un bloc valable presque pour lui-même et pavant le chemin improvisé et accidenté de Karim. Et cela à partir de l'expérimentation poético-pratique (Karim est poète et commente poétiquement son parcours) de l'impossibilité d'un retour conditionnant une fuite en avant parmi les survivances d'une Algérie ainsi saisie dans toutes ses multiplicités, depuis la Kabylie jusqu'aux Touaregs en remontant pour finir du côté de Constantine. Multiplicités des chants, des rituels et des énoncés critiques, diversité des formes culturelles et des formes de vie, épars fulgurants des jaillissements et des rencontres, toutes inoubliables : voir venir l'avenir, c'est aussi voir venir l'inoubliable en saisissant l'Algérie dans le divers éparpillé des multitudes qui, peu ou prou, sédentaires comme nomades, régionales et continentales, résistent à leurs manières aux normes nationales-étatiques (par exemple linguistiques) du pouvoir central. L'Algérie vue depuis la porte (africaine) de derrière et à partir des fragiles interstices que la massivité des plaques tectoniques de l'État-FLN et du fondamentalisme islamiste soustraient la plupart du temps au registre de la visibilité et du sensible. L'Algérie envisagée non pas comme État-nation en ses frontières démarqué mais comme chantier ouvert aux quatre vents d'une refondation perpétuellement relancée le long de la ligne d'horizon. Ici comme ailleurs, « il faut dégager de l'entre pour faire émerger de l'autre, cet entre que déploie l'écart et qui permet d'échanger avec l'autre, le promouvant en partenaire de la relation résultée. L'entre qu'engendre l'écart est à la fois la condition faisant lever de l'autre et la médiation qui nous relie à lui » (François Jullien in L'Ecart et l'entre. Leçon inaugurale de la Chaire sur l'altérité, éd. Galilée, 2012, p. 72 - et ces lignes écrites par le sinologue valent exemplairement aussi pour le cinéma de Wang Bing, par exemple pour Les Trois Soeurs du Yunnan). Ici, c'est par exemple un enfant qui, « brocanteur de l'humanité » comme le dirait Giorgio Agamben inspiré par Walter Benjamin, vole les chaussures de son père pour se fabriquer un joujou en affirmant que vivre relève aussi du détournement et du bricolage. Ailleurs, c'est le visage noirci par le soleil et creusé par le temps d'un homme du désert énonçant qu'être d'ici c'est vivre depuis l'origine du monde et qui, en fondu enchaîné, devient plaine sableuse balayée par le vent en ridule poussiéreuses. Il faudra également évoquer ces deux travellings latéraux qui se répondent symétriquement afin de brosser du côté de la fiction allégorique les lignes de fuite d'une existence renvoyant dos à dos les fanatismes mimétiques de la religion et du football. Il faudra aussi mentionner l'extraordinaire panoramique à 360° au nom duquel, à l'instar du personnage de Jack Nicholson dans Profession : reporter - The Passenger (1975) de Michelangelo Antonioni, le sujet filmant devient à son tout sujet filmé (par la femme qu'il voulait filmer et qui, par ce geste d'insolite retournement et d'insubordination, affirme un grand désir d'égalité dans le registre de la représentation). Impossible de tout décrire ici tant Chantier A épuise n'importe quelle entreprise d'exhaustion, et cela en vertu d'un rapport étrange à la durée qui, même si le film ne dure que 100 minutes, caresse le fantasme de l'indéfini (et, à ce titre, il est bien rare de prendre ce vieux cliché à revers ou à rebrousse-poil énonçant que plus un film est mauvais, plus il donne l'impression d'être interminable, précisément ici en nouant son appréciation à partir de la sensation qu'il pourrait durer beaucoup plus longtemps).
 Plus loin enfin, une lecture de Nedjma (1956) de Kateb Yacine et une projection de Éloge de l'amour (2001) de Jean-Luc Godard se feraient écho en ceci que le chantier décrit dans la première partie du roman comme l'enquête racontée dans la seconde partie du film valorisent au détriment de toute idée d'achèvement une vision dynamique, ouverte et processuelle. « Un adulte, ça n'existe pas » dit-on dans le film de Jean-Luc Godard (qui a par ailleurs souvent cité cette phrase d'André Malraux selon qui il n'y a pas de grande personne et selon qui aussi les gens sont plus malheureux qu'ils ne le pensent). Et un pays comme l'Algérie n'existerait peut-être pas davantage, consistant davantage qu'il n'existerait, idéalité ou sublimité qui formerait l'utopique socle commun partagé par une pluralité de formes de vie sociales et culturelles qui seraient libres, depuis leur immanente hétérogénéité, de bricoler leur autonomie comme elles le souhaitent. « Comme un art de la pensée qui se situerait par-delà toute doctrine, un art de la politique qui se situerait par-delà tout mot d'ordre, un art de l'histoire qui se situerait par-delà toute stricte chronologie » disait précédemment Georges Didi-Huberman. Et l'on aimerait ajouter que la puissance esthétique et donc politique de Chantier A, parce qu'elle se joue dans une perspective de pensée non-doctrinale de la multiplicité qui investirait autant l'histoire que la géographie, fait écho au geste tellurique et architectonique d'un autre grand film algérien vu cette année, Revolution Zendj de Tariq Teguia. De A (de Chantier A) à Z (de Revolution Zendj) en incluant dans les deux cas la nécessité significative d'en passer ou repasser par l'écran blanc (comme sable ou comme neige) comme par la case godardienne, ce serait là comme un abécédaire par le truchement duquel il faudrait alors finir par commencer et recommencer l'Algérie en en redessinant la carte depuis ses ouvertures et ses multitudes, ses temps et ses contretemps, ses jaillissements et ses incertitudes, ses plissements et ses interstices, ses survivances et ses discordances, sa mobilité et son hétérogénéité. Redonner de l'avenir à un pays victime d'une ossification étatique, subjugué depuis la fin du joug colonial par l'État-FLN ayant captivé la société (et dont l'énième symptôme en termes de capture ou de captivité aura été récemment donné à l'occasion de la réélection programmée de l'usé Abdelaziz Bouteflika) deviendrait ou redeviendrait ainsi la tâche urgente des cinéastes qui en sont issus, de part et d'autre de la Méditerranée. « Voir venir l'avenir », cela aura été aussi le chemin spécifiquement entrepris par le film de Tarek Sami, Lucie Dèche et Karim Loualiche qui auront rétrospectivement expérimenté que, si l'inépuisable est effectivement un nom possible de l'Algérie, l'épuisé, celui qui avoue particulièrement ici que son cœur palpite sans savoir pourquoi, aura été celui qui en aura jusqu'au plus profond de sa vie éprouvé l'onde sismique. C'est alors que Chantier A, un film dans lequel on chante par ailleurs beaucoup, ressemble, forcément après coup et imprévisiblement, au thrène, survivance du temps de la Grèce antique lorsque les funérailles s'accomplissaient en lamentations funèbres chantées par les aèdes se devant de rappeler les épisodes significatifs de la vie du défunt. Le thrène de l'épuisé, non pas parce qu'il aurait été fatalement victime d'une inépuisable Algérie (ce qui serait peut-être le cas de l'usé Abdelaziz Bouteflika), mais parce que l'inépuisable aura été vécu à son maximum d'intensité vitale par l'épuisé, au point d'abolition des intentions et de la succession linéaire des temps, et dans la dissolution du sujet filmant avec l'objet de son désir de filmer. Alors Chantier A ne serait pas loin de consoner avec le thrène évoquant l'exposition du cadavre d'Hector dans le Chant XXIV de l'Iliade de Homère qui commence ainsi : « Ils ramenèrent le héros dans sa noble demeure / Et le placèrent sur un lit sculpté ».
Plus loin enfin, une lecture de Nedjma (1956) de Kateb Yacine et une projection de Éloge de l'amour (2001) de Jean-Luc Godard se feraient écho en ceci que le chantier décrit dans la première partie du roman comme l'enquête racontée dans la seconde partie du film valorisent au détriment de toute idée d'achèvement une vision dynamique, ouverte et processuelle. « Un adulte, ça n'existe pas » dit-on dans le film de Jean-Luc Godard (qui a par ailleurs souvent cité cette phrase d'André Malraux selon qui il n'y a pas de grande personne et selon qui aussi les gens sont plus malheureux qu'ils ne le pensent). Et un pays comme l'Algérie n'existerait peut-être pas davantage, consistant davantage qu'il n'existerait, idéalité ou sublimité qui formerait l'utopique socle commun partagé par une pluralité de formes de vie sociales et culturelles qui seraient libres, depuis leur immanente hétérogénéité, de bricoler leur autonomie comme elles le souhaitent. « Comme un art de la pensée qui se situerait par-delà toute doctrine, un art de la politique qui se situerait par-delà tout mot d'ordre, un art de l'histoire qui se situerait par-delà toute stricte chronologie » disait précédemment Georges Didi-Huberman. Et l'on aimerait ajouter que la puissance esthétique et donc politique de Chantier A, parce qu'elle se joue dans une perspective de pensée non-doctrinale de la multiplicité qui investirait autant l'histoire que la géographie, fait écho au geste tellurique et architectonique d'un autre grand film algérien vu cette année, Revolution Zendj de Tariq Teguia. De A (de Chantier A) à Z (de Revolution Zendj) en incluant dans les deux cas la nécessité significative d'en passer ou repasser par l'écran blanc (comme sable ou comme neige) comme par la case godardienne, ce serait là comme un abécédaire par le truchement duquel il faudrait alors finir par commencer et recommencer l'Algérie en en redessinant la carte depuis ses ouvertures et ses multitudes, ses temps et ses contretemps, ses jaillissements et ses incertitudes, ses plissements et ses interstices, ses survivances et ses discordances, sa mobilité et son hétérogénéité. Redonner de l'avenir à un pays victime d'une ossification étatique, subjugué depuis la fin du joug colonial par l'État-FLN ayant captivé la société (et dont l'énième symptôme en termes de capture ou de captivité aura été récemment donné à l'occasion de la réélection programmée de l'usé Abdelaziz Bouteflika) deviendrait ou redeviendrait ainsi la tâche urgente des cinéastes qui en sont issus, de part et d'autre de la Méditerranée. « Voir venir l'avenir », cela aura été aussi le chemin spécifiquement entrepris par le film de Tarek Sami, Lucie Dèche et Karim Loualiche qui auront rétrospectivement expérimenté que, si l'inépuisable est effectivement un nom possible de l'Algérie, l'épuisé, celui qui avoue particulièrement ici que son cœur palpite sans savoir pourquoi, aura été celui qui en aura jusqu'au plus profond de sa vie éprouvé l'onde sismique. C'est alors que Chantier A, un film dans lequel on chante par ailleurs beaucoup, ressemble, forcément après coup et imprévisiblement, au thrène, survivance du temps de la Grèce antique lorsque les funérailles s'accomplissaient en lamentations funèbres chantées par les aèdes se devant de rappeler les épisodes significatifs de la vie du défunt. Le thrène de l'épuisé, non pas parce qu'il aurait été fatalement victime d'une inépuisable Algérie (ce qui serait peut-être le cas de l'usé Abdelaziz Bouteflika), mais parce que l'inépuisable aura été vécu à son maximum d'intensité vitale par l'épuisé, au point d'abolition des intentions et de la succession linéaire des temps, et dans la dissolution du sujet filmant avec l'objet de son désir de filmer. Alors Chantier A ne serait pas loin de consoner avec le thrène évoquant l'exposition du cadavre d'Hector dans le Chant XXIV de l'Iliade de Homère qui commence ainsi : « Ils ramenèrent le héros dans sa noble demeure / Et le placèrent sur un lit sculpté ».



 Vérifiez sur
Vérifiez sur 

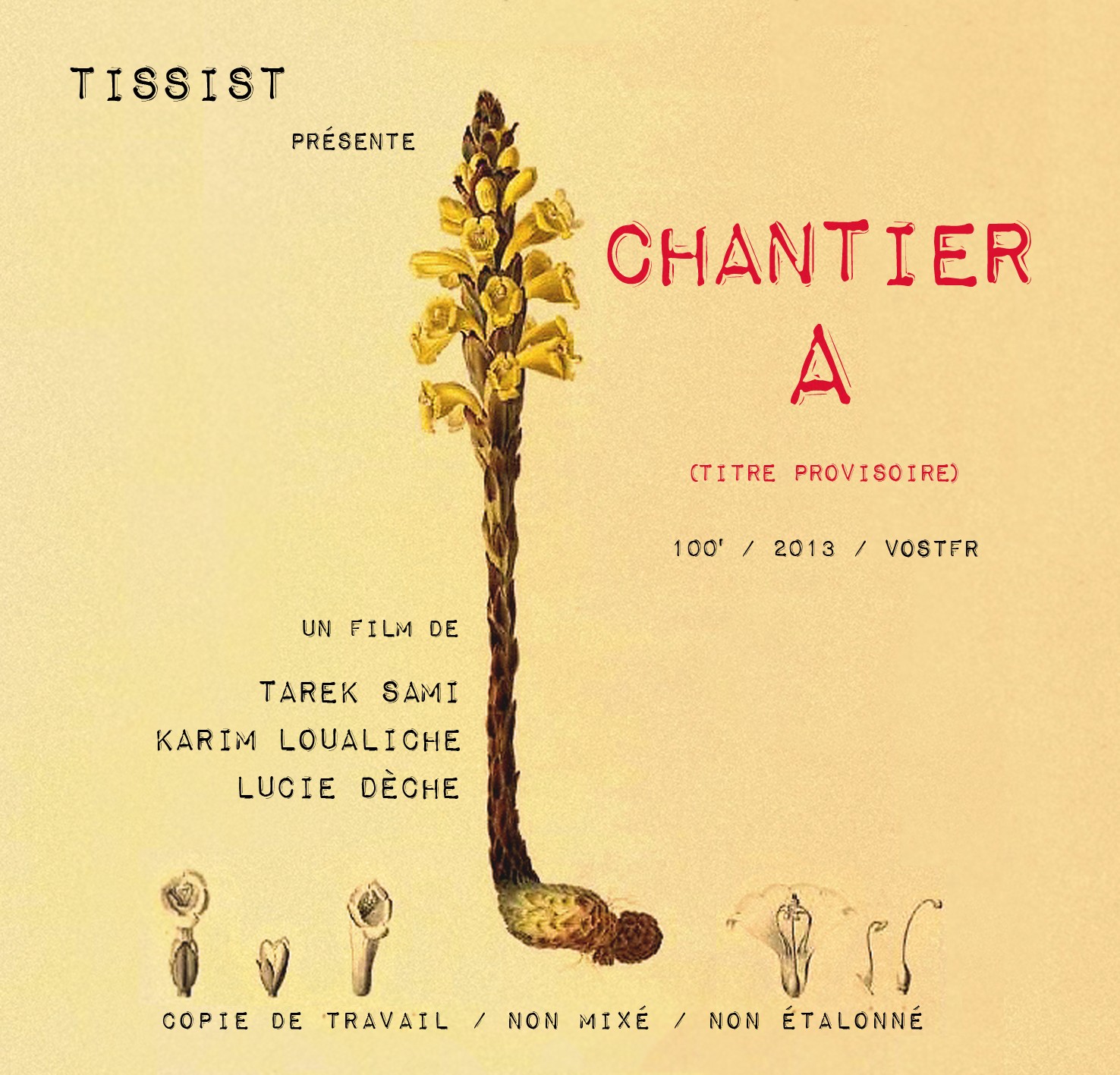
 Plus loin enfin, une lecture de
Plus loin enfin, une lecture de