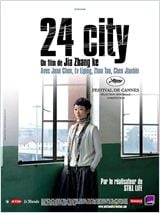I Wish I Knew (2010)
de Jia Zhang-ke
Histoires de fantômes de Shanghai
« La rhétorique de la prétendue contradiction de la Chine
– entre autre une économie de marché avec un Etat autoritaire –
la privatisation, la marchandisation et la dérégulation ou la stabilisation
au nom du retrait de l’Etat sont toujours compatibles avec le désir d’un nouveau genre d’Etat fort »
(Wang Hui, « Notre avenir en débat : la politique intellectuelle dans la Chine contemporaine »
in L’Idée communiste [sous la direction d’Alain Badiou et Slavoj Zizek], éd. Lignes, 2010, p. 298-299)
Chaque nouveau long métrage de Jia Zhang-ke, l’un des plus importants cinéastes chinois en activité, apporte encore la preuve que le geste esthétique supportant toute son œuvre n'a de cesse de vouloir étendre, dans l'espace et dans le temps, et par-delà la distinction consensuelle entre la fiction et le documentaire, le champ des réponses apportées à la question cruciale que posent tous ses films : quel devenir pour un peuple chinois aspiré par la paradoxale libéralisation mondiale d'une économie nationale toujours inféodée à l'autoritarisme étatique du communisme post-maoïste ? C'est le philosophe marxiste Henri Lefebvre qui disait que les paradoxes étaient des contradictions non perçues comme telles. Ce qui apparaît comme un paradoxe (la Chine, en tant que son organisation étatique autoritaire s'affirme idéologiquement comme communiste, est l'un des pays les plus dévoués à l'intégration dans la mondialisation capitaliste) relève en fait de la contradictoire survie économique d'un Etat qui, pour perpétuer son conatus idéologique communiste, a substitué à l'autisme des solutions albanaise ou nord-coréenne la décision d'un abandon au champ concurrentiel de la valorisation mondiale du capital. Le paradoxe idéal ressortirait de l'improbable union du communisme et du capitalisme qui représentent deux modèles économiques antagonistes, alors que la contradiction réelle exprime que le meilleur véhicule politique du capitalisme consisterait peut-être dans l'étatisme autoritaire qui constitue la vérité politique du communisme chinois (c’est bien pourquoi Alain Badiou a raison d’affirmer que le renouveau de l’hypothèse communiste doit désormais s’accomplir avec la dés-identification du communisme avec l’Etat et sa prise par la forme-parti qui en a justifié la logique tout au long du 20ème siècle). En ce sens, l'Etat fort du modèle chinois qui joue le double jeu de la libéralisation des capitaux et d'une politique industrielle soutenue peut concurrencer et dépasser le modèle anglo-saxon s'agissant d'un Etat faible promu par le néolibéralisme, tout à la fois en retrait sur le plan de la redistribution des richesses et des services publics et mobilisé sur le plan régalien (notamment sécuritaire). « L’auto-contradiction ou l’argument paradoxal est la caractéristique du néolibéralisme, qui tend à dissimuler en particulier le rapport entre son idéologie et sa pratique, par exemple la juxtaposition de la division entre la politique et l’économie, le retrait de l’Etat et l’intervention étatique dans l’imposition du processus de privatisation, l’existence du pouvoir politique dans les activités marchandes. Le néolibéralisme est par voie de conséquence une idéologie qui a été utilisée pour défendre le processus de redistribution de la propriété publique au nom des prétendus droits de la propriété privée » (Wang Hui, opus cité, p. 299).
Et le paradoxe n'est définitivement plus une contradiction quand les films réalisés par Jia Zhang-ke ou d'autres cinéastes issus de la même génération critique (la « sixième » génération : Lou Ye, Zhao Liang, Wang Bing, Yu Lik-wai – ce dernier est aussi le directeur de la photographie attitré de l’auteur de I Wish I Knew) sont soumis à la censure d'un Etat qui cherche par tous les moyens à entretenir le déni idéologique sur son caractère schizophrénique. Suprême ruse de la raison hégélienne : le communisme chinois est la continuation de la mondialisation du capitalisme par d'autres moyens que ceux proposés par le libéralisme habituel. « L’auto-contradiction ou l’argument paradoxal est la caractéristique du néolibéralisme, qui tend à dissimuler en particulier le rapport entre son idéologie et sa pratique, par exemple la juxtaposition de la division entre la politique et l’économie, le retrait de l’Etat et l’intervention étatique dans l’imposition du processus de privatisation, l’existence du pouvoir politique dans les activités marchandes. Le néolibéralisme est par voie de conséquence une idéologie qui a été utilisée pour défendre le processus de redistribution de la propriété publique au nom des prétendus droits de la propriété privée » (Wang Hui, opus cité, p. 299). Que devient alors le peuple chinois, pris dans la double tenaille du faux communisme égalitaire se révélant capable de combiner à la fois un vrai étatisme autoritaire et un vrai capitalisme libéral ? Que devient ce peuple chinois, aujourd'hui victime de la double peine de l’écrasement des libertés individuelles par la surdétermination étatique de la vie sociale et de la subjugation des libertés collectives sous la concurrence capitaliste ? Que devient-il, c'est-à-dire quel est son devenir ? D'où vient-il et où va-t-il ? C'est la singulière puissance esthétique du geste cinématographique défendu par Jia Zhang-ke que d'alterner fiction et documentaire – mieux c'est une alternance qui se joue par-delà les films en leur sein même comme c’est admirablement le cas avec 24 City (2008) – afin d'exemplifier les enjeux politiques et sociaux d'un pays en pleine mutation structurelle, et cela dans les termes dialectiques de l'enregistrement objectif des situations réelles et de la mise en scène de récits subjectifs soutenus par la croyance en une réappropriation symbolique et collective des événements vécus. En ce sens, Jia Zhang-ke s’inscrit parfaitement dans la tradition esthétique qui commence avec Joris Ivens et Georges Rouquier, continue avec Jean Rouch et Lionel Rogosin, et se prolonge aujourd’hui avec Rithy Panh et Pedro Costa ou Miguel Gomes – tous des grands artistes de cinéma clamant sans craindre les accusations de populisme (à l’instar de John Ford et Jean Renoir, Pier Paolo Pasolini et Maurice Pialat en leurs temps) que « Le peuple est là » (cf. la revue de cinéma Vertigo, éd. Lignes, n° 37, 2010, 111 p.).
1/ Le cinéma de Jia Zhang-ke : les lieux par où s'énonce le devenir du peuple chinois

Il suffit de jeter un coup d'œil rétrospectif sur l'œuvre du cinéaste (diplômé de l’Académie du film de Pékin en 1997, il a tourné cette année-là son premier long métrage dans sa ville natale de Fenyang, Xiao Wu, artisan pickpocket, film précédé par un court-métrage fauché, Xiao Shan rentre à la maison tourné en 1995) pour comprendre à cette occasion le chemin parcouru jusque-là. Un chemin qui relève tout à la fois de la sociologie et de l'histoire, de l'économie et de la culture, et qui saisit tout cela à partir d'une perspective synthétique selon laquelle d’une part le présent ne peut se comprendre qu’à la lumière de son passé, et selon laquelle d’autre part le documentaire et la fiction se conjuguent plutôt qu'ils ne s'opposeraient, ceci afin de toucher autant aux réalités éprouvées qu’aux efforts de symbolisation entrepris par un peuple jusqu’ici cantonné à l’objective et passive massivité que lui prescrit l’Etat autoritaire et gestionnaire chinois, un peuple ainsi dépris de la multitude de ses possibilités (narratives) subjectives. Xiao Wu, artisan pickpocket rend déjà compte des marges de manœuvre offertes par une économie informelle lucrative (le trafic de cigarettes dont profite Xiao Wong s’est substitué au vol à la tire pratiqué par le héros éponyme), pendant que les restructurations du tissu urbain (les vieux quartiers de Fenyang rasés) et rural (les parents paysans appauvris du protagoniste) exemplifient les nouvelles orientations sociales de la politique industrielle nationale. Avec Platform (2000), le cinéaste, davantage inspiré ici par le taïwanais Hou Hsiao-hsien que par le néoréalisme italien et Robert Bresson, use de cadres fixes et larges, du plan-séquence et de la profondeur de champ, afin de déployer l’espace temporel déterminant l’arrière-plan historique relatif à la situation de Fenyang décrite dans le film précédent. Avec le récit d’une troupe de spectacle pendant dix ans (de 1979 à la fin des années 1980), la perspective ici privilégiée est historico-culturelle, et le passage entre les mises en scène à la gloire du président Mao et les concerts pop-rock vaut pour une expression privilégiée d’une libéralisation des formes et représentations accompagnant dans l’arrière-scène invisible l’entrée des capitaux étrangers au sein du marché national. In Public (2001) renoue avec certains personnages du film précédent (Min-liang interprété par Wang Hong-wei, déjà l’interprète du pickpocket Xiao Wu), mais s’attache à élargir la captation documentaire d’un lieu (la ville de Datong dans la région du Shanxi, naguère spécialisée dans l’extraction industrielle du charbon) saisi dans les processus d’une déréliction sociale (ouvriers au chômage et usines abandonnées), d’une désertification industrielle partiellement symptomatique d’une financiarisation de l’économie chinoise intégrée dans l’espace mondial de la valorisation et de l’accumulation du capital. Entre I Vitelloni (1952) de Federico Fellini, Mean Streets (1973) de Martin Scorsese et Goodbye South, Goodbye (1997) de Hou Hsiao-hsien, Plaisirs inconnus (2002) prolonge le travail d’objectivation documentaire de la désertification frappant Datong, en y inscrivant cette fois-ci le récit fictionnel d’un désœuvrement de la jeunesse à la fois victime de l’immobilisme social (le chômage de masse) et de sa fascination pour les fétiches du consumérisme occidental importés en Chine (téléphones portables, ordinateurs connectés à l’Internet). Le portrait d’une jeunesse clivée, à la fois pétrifiée (par le chômage) et médusée (par le fétichisme consumériste), permet au cinéaste de donner un nouveau tour d’écrou à ce qui avait été exposé dans son premier long métrage. N’y retrouve-t-on d’ailleurs pas Xiao Wu qui, devenu chef de bande, vérifie ainsi la règle économique contemporaine de l’enrichissement rapide d’une minorité désindexé de l’idéologie ouvriériste et travailliste défendue par l’Etat chinois ? S’il est ici question de la désuétude du modèle économique de la planification étatique au bénéfice d’une économie ouverte sur les valeurs (capitaliste, consumériste, mafieuse) du monde occidental. The World (2004) pousse l’ambition encore plus loin, en pénétrant dans les enceintes du parc à thèmes pékinois World Park qui contient les versions miniaturisées des plus célèbres monuments du monde entier.
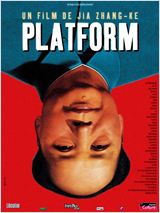
Entre Platform et The World, c’est le parachèvement de l’indexation de la culture nationale chinoise sur les simulacres valorisés par le consumérisme mondial (c’est le petit côté Playtime de The World). C’est que Jia Zhang-ke filme ce qui, dans la Chine, est plus qu’elle-même, ce qui l’excède : la mondialisation du capital. La pluralité des origines ou des destinations de personnages (Russie, Mongolie, le quartier de Belleville à Paris) atteste de la situation de grand échangeur mondial qu’est devenue après les Etats-Unis la Chine, comme happée par une tendance à un devenir immatériel (les signes flottants de la monoculture mondialisée – « l’occidentalisation du monde » dont parlait Martin Heidegger) incessamment contrariée par cette contre-tendance qu’est l’agitation (parfois tragique) du prolétariat s’activant à faire fonctionner l’usine spectaculaire comme la réalité ouvrière des chantiers (toutes choses jamais complètement recouvertes par l’ivresse de la fantasmagorie marchande). En même temps que le personnage de Qun, une styliste arrivée à l’âge de 18 ans à Pékin qui s’enrichit dans la contrefaçon de modèles de haute-couture européens, annonce les enjeux proposés par Useless (2007), un documentaire attaché à la personne de Ma Ke, une styliste qui veut imposer sur le marché mondial sa marque afin de prouver que la Chine a autre chose à offrir que sa main-d’œuvre bon marché issue de l’industrie textile. Si un voyage en France lors de la semaine de la mode automne / hiver accomplit le vœu de la styliste, un détour (fictionnel) par la province de Shanxi et l’incontournable cité natale de Fenyang exprime ultimement les contradictions du capitalisme chinois, capable de soutenir dans le même mouvement inégalitaire une industrie du luxe minoritaire et une prolétarisation majoritaire d’individus contraints de vendre leur force de travail ouvrière, faute d’avoir pu s’établir comme artisans. L’absence de valeur d’usage que ramasse frontalement le titre du documentaire expose le double symptôme du triomphe de la valeur d’échange (marchande) sur la valeur d’usage, et de la mobilisation de cette victoire capitaliste afin de vendre au monde entier le prestige national chinois (cette mobilisation instruit par conséquent de la transformation actuellement nécessaire d’une partie du capital économique en capital symbolique afin de parachever la situation préférentielle de la Chine dans le concert de la mondialisation capitaliste). Là où Jia Zhang-ke arrive à abolir la distinction entre documentaire et fiction au nom de l’égalité esthétique du constat objectif et du récit subjectif (des formes de l’art et des formes de la vie, comme le dirait Jacques Rancière), l’économie marchande se voit structuralement incapable de distinguer valeur d’usage et valeur d’échange au profit de la surdétermination hiérarchique du second terme par rapport à celui qui le précède, comme le pouvoir chinois s’acharne à identifier, par-delà les dénis idéologiques, autoritarisme étatique aux couleurs passées du socialisme réel et capitalisme libéral plus débridé encore que dans les pays anglo-saxons.
Entre The World et Useless, nous trouvons le superbe diptyque Still Life / Dong (2006), premier climax de l’œuvre de Jia Zhang-ke. En effet, entre la fiction tournée à Fengjie dans la province de Hubei après que les eaux du barrage des Trois-Gorges aient englouti une partie du tissu local (plus d’un million de personnes déplacées, des milliers de villages et de sites archéologiques dévastés), et le documentaire tourné au même endroit et au centre duquel on trouve le peintre Liu Xiao-dong dont les grandes toiles ont inspiré plastiquement Still Life (ce film a reçu le Lion d’or à la Mostra de Venise), il y a l’expression du caractère biface d’un dispositif cinématographique qui considère une région à partir des mécanismes objectifs qui participent à la ruiner (la logistique étatique au service d’un projet gigantesque à portée mondiale rêvé par Mao et réalisé par les capitaux étrangers), comme à partir des processus artistiques qui en extraient la puissance esthétique afin de manifester les rapports connexes entre dévastation et sublimation. L’autre face du sublime, c’est donc la ruine (il y aurait alors du romantisme chez le cinéaste), ou bien la ruine est l’avers du sublime qui en est l’envers. Voilà ce dont témoigne dialectiquement le diptyque Still Life / Dong, en plus d’incarner le passage du numérique DV au numérique HD (quand In Public et Plaisirs inconnus incarnaient le passage entre l’argentique et la technologie numérique, et quand I Wish I Knew représente un retour temporaire à l’argentique), de consacrer autant la musique planante et ambient de Lim Giong que la figure natatoire du travelling latéral en liaison avec un monde dont la dévastation est synonyme de liquidation (le numérique renforce également cet aspect liquide aussi déterminé par la financiarisation de l’économie chinoise), de faire subtilement raccord avec les films précédents (on retrouve l’actrice préférée du cinéaste depuis Platform, Zhao Tao, et le bateau de Still Life se nomme The World), et enfin d’élargir à partir de la Chine la vision de l’espace mondial de son inscription (en attendant la France pour la styliste Ma Ke, le peintre Dong part en Thaïlande, et on a d’ailleurs l’impression d’y croiser les prostituées cambodgiennes du film de Rithy Panh, La Papier ne peut pas envelopper la braise sorti en 2007). 24 City (2008), deuxième sommet de l’œuvre, réussit à synthétiser en un seul film les acquis esthétiques du diptyque en y associant le perspectivisme mémoriel et historique dégagé par Platform (l’archive ne provient pas ici de l’extérieur du film, mais est produite directement de lui, les témoignages concourant ainsi à produire une mémoire collective et populaire indépendante – et même antithétique – au propagandisme archiviste et historiciste propre à l’Etat chinois). Exemplaire est ici la saisie au travers de huit entretiens (quatre documentaires et quatre fictionnels – on retrouve les actrices Zhao Tao ainsi que Joan Chen) des processus historiques de démantèlement du complexe militaro-industriel de Chengdu, capitale de la province du Sichuan, de 1945 à nos jours, auquel le pouvoir a substitué un parc résidentiel de haut standing destiné à la nouvelle bourgeoisie chinoise.
On comprend mieux avec ce film les opérations cinématographiques d’indiscernabilité entre le documentaire et la fiction auxquelles s’est jusque-là livré Jia Zhang-ke : quand le documentaire assure symboliquement une véridicité des récits fictionnels, la fiction expose les forces de l’imaginaire et de la création subjectives qui ressaisissent les témoignages documentaires pour les consacrer en tant qu’œuvre d’art dissensuelle séparée ou distincte du consensus culturel étatique. Raconter, c’est créer, et créer, c’est résister comme le disait Gilles Deleuze. La déstructuration étatique de la classe ouvrière stratifiée sur plusieurs générations de Chengdu, effectuée au nom de la tertiarisation du tissu économique, de la « bourgeoisification » (Immanuel Wallerstein) d’une frange minoritaire de la population nationale, et de la concurrence financière mondiale exemplifie l’identité structurale entre autoritarisme étatique (malgré les couleurs communistes) et capitalisme libéral (malgré les beaux habits de la démocratie formelle). En même temps que le cinéaste sauve de cette ample liquidation ou dévastation enregistrée en longs monologues et travellings latéraux toute une mémoire ouvrière, incarnation d’une narration collective dont la parole populaire, inaudible pour le pouvoir et sa fallacieuse idéologie ouvriériste, manifeste ultimement la distinction politique entre la société et l’Etat. L’objectivation cinématographique de l’intervalle séparant le peuple de l’Etat censé le représenter et préserver ses intérêts expose en dernière instance la qualité dissensuelle et politique d’un geste esthétique que Jia Zhang-ke peaufine à chaque film, et qui n’est pas exempt de lyrisme, à l’instar du chef-d’œuvre épique de Wang Bing, A l’ouest des rails (2003). Les histoires de la cité de Shanghai contées dans I Wish I Knew (2010), le nouveau long métrage du cinéaste produit dans le cadre de l’exposition universelle qui a eu lieu dans cette mégalopole de 18 millions d’habitants (le documentaire tourné en 35 mm. – ce retour circonstancié à la pellicule manifeste techniquement un confort économique prodigué par la production – a été montré à la sélection « Un certain regard » lors du dernier Festival de Cannes), s’inscrivent dans la même perspective mémorialiste et généalogique, historique et matérialiste (comme aurait dit Walter Benjamin) selon laquelle la rédemption cinématographique du passé offre au peuple chinois opprimé, dans le miroir présent de ses ruines, l’image de sa mémoire retrouvée ainsi que celle de son devenir émancipatoire possible.
2/ I Wish I Knew : la gloire capitaliste est le deuil éclatant de la politique communiste
Le site du ciné-club de Caen présente une liste exhaustive et détaillée des dix-huit témoignages recueillis par Lin Xudong (monteur de 24 City, ce professeur à l’université de la télévision de Pékin est originaire de Shanghai et parle le shanghaien contrairement au cinéaste) et Chen Danqing qui forment la trame narrative – voire les chapitres – de ce « roman de Shanghai » (comme le signale le titre secondaire du film de Jia Zhang-ke) que constitue I Wish I Knew (http://www.cineclubdecaen.com/realisat/jiazhangke/iwishiknewhistoiresdeshanghai.htm). En voici donc le détail :
1/ Yang Xiao-fo, né en 1919, est témoin en 1933, à l’âge de 15 ans, de l’assassinat de son père par quatre hommes armés, Yang Xing-fo (1893-1933), né à Qingjiang, province du Jiangxi, scientifique en gestion économique, pionnier du mouvement chinois des Droits de l’Homme (il a rejoint l’Alliance Révolutionnaire Chinoise en 1910).
2/ Zhang Yuan-sun (petit-fils de Zhang Yi-yun), né à Shanghai en 1930. Zhang Yi-yun (1871-1933), est né à Zhenhai, province de Zhejiang. En 1890, alors qu’il n’a que 19 ans, il est lauréat au niveau provincial des examens impériaux.
3/ Du Mei-ru, née à Shanghai en 1930, a habité à Hong Kong, Taïwan puis la Jordanie. Elle dirige actuellement un restaurant chinois à Amman. Du Yuesheng (1888-1951), sa mère née à Gaoqiao (Pudong District de Shanghai), était membre de la triade du « Gang Vert » et l’une des gangsters les plus réputées du Shanghai moderne. Du Yue-sheng, Huang Chin-jung et Zhang Xiao-lin étaient connues sous le nom des « Trois magnats de Shanghai ».
4/ Wang Pei-min (deuxième fille de Wang Xiao-he, militant du Parti communiste chinois clandestin) est née à Shanghai en 1948, a été éditrice du Shanghai Yearbook. Wang Xiao-he (1924-1948) est né à Shanghai. Admis au Collège anglais de Lizhi, il rejoint le Parti communiste chinois en 1943. A 24 ans, il est exécuté à la prison Tilanqiao de Shanghai.
5/ Wang Toon (fils de Wang Zhong-lian), né en 1942, est l’un des fils de Wang Zhong-lian. Après avoir quitté Shanghai pour Taïwan avec sa famille en 1949, il est devenu l’un des plus célèbres réalisateurs taïwanais. Ses films les plus connus sont Days to See the Sea, Scarecrow, Banana Paradise, Silent Hill, et Red Persimmon. Wang Zhong-lian (1903-1991) est né dans le Comté de Xiao, Province de Anhui. Au printemps 1924, il est admis à l’Académie Militaire de Whampoa. Après le déclenchement de la guerre Sino-japonaise, il devient le 85ème commandant de l’armée, puis est promu lieutenant général de l’armée en 1939.
6/ Chang Hsin-I (arrière petite-fille de Zeng Guo-fan, petite-fille de Nie Ji-gui, fille de Zhang Qi-huang), née à Shanghai en 1916, a été écrivaine et une traductrice reconnue (elle parle encore le shanghaien des années 1930). Elle fut l’épouse de l’ancien ministre des finances taïwanais Fei Hua. Zeng Guo-fan (1811-1872), né dans le Comté de Xiangxiang, Changsha, province du Hunan, était stratège militaire de la Dynastie Qing, philosophe, homme d’état, calligraphe et écrivain. Il a fondé et commandé l’armée Xiang. Nie Ji-gui (1855-1911) est né à Hengshan, province du Hunan. Il était le gendre de Zeng Guo-fan. Nie était un bureaucrate capitaliste dans les dernières années de la Dynastie Qing. Zhang Qi-huang (1877-1927), né dans le comté de Yongfu dans la province du Guangxi, a été le lauréat des examens impériaux en 1904.
7/ Barbara Fei est une célèbre soprano. Elle est la nièce de Fei Yi-min, directeur du Ta Kung Pao, quotidien de Hong Kong et la fille du célèbre réalisateur Fei Mu. Le réalisateur chinois Fei Mu (1906-1951) est né à Shanghai. Ses principaux films sont : City Night, Life, Sea of Fragrant Snow, Family, Bloodshed on Wolf Mountain, et Confucius..
8/ Wei Ran (fils de Shang-guan Yun-zhu), né à Shanghai en 1951, est le fils de l’actrice Shang-guan Yun-zhu et de son troisième mari, Cheng Shu-yao. Wei a étudié la peinture et travaillé comme éditeur au China Construction Industry Press, qui couvre le domaine du business à Shanghai. Shangguan Yun-zhu (1920-1968), née à Jiangyin, province du Jiangsu, était l’une des actrices chinoises les plus connues.
9/ Zhu Qian-sheng, qui a été membre de l’équipe shanghaienne de Chung Kuo tourné par Michelangelo Antonioni en 1972, est né à Guizhou en 1942 : il est journaliste d’investigation pour la Shanghai Television et a été récompensé comme l’un des « Shanghai’s Top Ten Reporters » en 1988.
10/ Chen Dan-qing, né à Shanghai en 1953, est peintre et écrivain.
11/ Chang Ling-yun, né en 1927, est le maire de Zhongzhen New Village, Hsinchu City, Taiwan.
12/ Lee Chia-tung, né à Shanghai in 1939, est ingénieur diplômé en génie électrique de l’université de Taïwan. En 1963, il obtient un master en génie électrique à Berkeley en Californie puis, en 1967, un doctorat dans la même université.
13/ Hou Hsiao-hsien, né dans le comté de Mei (province de Guangdong) en 1947, a immigré à Taïwan avec sa famille en 1948 : il est la figure principale de la nouvelle génération de réalisateurs taïwanais.
14/ Huang Bao-mei, né à Shanghai en 1931, a été ouvrier à la 17ème usine de coton de Shanghai. Il a été honoré de plusieurs récompenses dont celles d’ouvrier modèle de Shanghai, d’ouvrier modèle de l’industrie textile nationale, et il a été 7 fois promu ouvrier modèle chinois.
15/ Wei Wei, née à Zhongshan, province de Guangdong en 1918, a joué le rôle de Zhou Yu-wen dans Spring in a Small Town de Fei Mu.
16/ Rebecca Pan, née à Shanghai en 1931, est chanteuse et actrice. Elle a souvent joué la femme de Shanghai dans les films de Wong Kar-Wai (par exemple Days of Being Wild en 1990).
17/ Yang Huai-ding, né à Shanghai en 1950, est surnommé « Yang le Millionnaire ». En 1988, il gagne son premier lingot d’or en négociant des bons du Trésor.
18/ Han Han, né à Shanghai en 1982, est un écrivain célèbre dont les réussites commerciales lui ont permis de devenir coureur automobile.

Si I Wish I Knew s’inscrit exemplairement dans la manière esthétique du cinéaste en proposant une balade urbaine et mémorielle qui ainsi vérifie à nouveau les rapports structuraux entre espaces et actes de paroles (le lieu est un terme étymologiquement issu du latin « locus » qui a donné par exemple « locution » : le lieu, c’est l’endroit d’où l’on parle ; le lieu, c’est la prise de position déterminant une prise de parole), le dispositif cinématographiquement qui en soutient formellement la portée propose des éléments de différenciation avec 24 City dont il ne s’agissait pas de répéter la formule pour la commerçante et financière Shanghai désormais substituée à l’ouvrière Chengdu. Déjà, et de façon plus simple que le film précédent, les témoignages relèvent ici d’un geste strictement documentaire, pendant que les intervalles entre les entretiens que représentent les moments de transition assurés par l’actrice habituelle Zhao Tao exposent les plis d’une perspective allégoriste générale permettant ainsi la ressaisie dialectique de toutes les séquences du film. Nous avons certes affaire ici à une économie cinématographique moins inventive que celle à l’œuvre dans 24 City, parce qu’elle ne repose pas aussi subtilement sur l’indistinction entre le documentaire et la fiction. Mais il faut préciser que la matière sociologique collectée par le cinéaste est aussi plus fournie, plus hétérogène (sans compter aussi que les interviewés évoquent souvent leurs parents dont la présence spectrale se joint ainsi à celle des vivants), et elle trouve à s’articuler avec l’autre matériau dont se nourrit le film, à savoir les extraits de films. De Rebecca Pan revenant de Days of being Wild (1990) du hongkongais Wong Kar-waï (on se souvient du clin d’œil ironique à l’auteur de In the Mood for Love dans Plaisirs inconnus), au cinéma influent de Hou Hsiao-hsien (dont on voit un extrait du sublime Flowers of Shanghai tourné en 1998) interviewé dans les trains taïwanais qu’il aura filmé, en passant par les éclats issus de Suzhou River (1997) de Lou Ye dont les ouvriers au travail de la destruction d’un bâtiment rappellent ceux de Still Life (il faut ici insister que le fait que Jia Zhang-ke s’inspire formellement du montage heurté pratiqué par Lou Ye quand il filme à son tour le fleuve Suzhou) et par les extraits de films de propagande chantant la gloire de Mao et de la révolution communiste, I Wish I Knew se présente ainsi comme un véritable kaléidoscope cinématographique, avec ses multiples faces que le cinéaste agence afin d’obtenir l’image multidimensionnelle sur le plan spatio-temporel de Shanghai, cité où se côtoient l’extrême richesse et de l’extrême pauvreté, comptoir colonial et commercial hier et centre financier aujourd’hui qui pourtant, malgré l’amnésie présente, fut en 1966 le point de départ de la Révolution culturelle. Les travellings savamment composés, la blancheur crémeuse et onirique d’une lumière découlant de la surexposition des plans, et la lenteur quasi-cérémoniale des mouvements associée à l’emploi de longues focales pour ressaisir la mégalopole shanghaienne selon la dense rythmicité de ses ondes urbaines trouvent à s’articuler avec des témoignages d’individus évoquant le passé (c’est bien par le prisme de la mémoire familiale que l’histoire collective arrive à individuellement s’énoncer) La parole des vivants faisant monter la virtuelle présence des fantômes venus du passé est également mise en scène en fonction de l’importance symbolique et mémorielle des lieux d’énonciation. Les images documentaires s’emboitant en fonction de la série formelle à laquelle elles appartiennent (vues de la ville ou témoignages collectés) se trouvent aussi imbriquées dans les images tirées d’extraits de films réalisés par des Shanghaiens ayant ou non migré ou par certains de leurs descendants. Enfin, la volatile présence de Zhao Tao se baladant silencieusement dans les rues de Shanghai (on pense ici au fantôme hirsute du beau documentaire de Du Haibin, 14 28, présenté lors du Festival du Cinéma du Réel de 2010) parachève la portée allégorique d’un film dont la démarche est définitivement celle de la déambulation et de l’imprégnation. Filmage impressionniste et montage cubiste, plasticité des images et sens romanesque ou feuilletonesque de la narration : I Wish I Knew déplie, tel l’éventail tenu en main par Zhao Tao, une perspective mémorialiste contestant l’imposition idéologique de l’histoire existante – ce qui a valu au film de Jia Zhang-ke commandé par Shanghai dans le cadre de l’Exposition universelle d’avoir été contesté par ses producteurs (un remontage contraint n’aura même pas suffi à permettre au film d’être montré par le pavillon chinois lors de l’exposition).
Ce dé-pli temporel participe aussi d’un déplacement topologique de la Chine continentale au port riche de plusieurs vies successives (Shanghai, c’est la cité commerçante qui fut ouverte sur le monde occidental depuis le traité de Nankin en 1842, occupée par l’armée japonaise lors de la guerre sino-japonaise en 1937, muselée lors de l’avènement de la République populaire de Chine en 1949, effervescente lors de la Révolution culturelle en 1966, et commercialement ré-ouverte en 1992 sous l’impulsion « libérale » de Deng Xiaoping). Un déplacement qui entraîne lui-même d’autres déplacements (démarré en 2009 et fini pour l’Exposition universelle de 2010, le film de Jia Zhang-ke accomplit une grande rotation puisqu’il s’aventure à Taïwan et Hong-Kong pour revenir sur Shanghai) qui sont symptomatiques du mouvement diasporique chinois après que le Parti communiste ait remporté une victoire décisive sur le Kuomintang, le parti nationaliste de Tchang Kaï-chek alors obligé de se replier sur l’île de Taïwan pour former un gouvernement national distinct et opposé à la République populaire de Chine alors instituée. Si Still Life et 24 City rendaient compte des mouvements de population déterminés par la politique industrielle de l’Etat chinois d’hier (à l’époque de la planification décrétée par Mao) à aujourd’hui (à l’heure de la mondialisation capitaliste), I Wish I Knew montre comment les divisions politiques pendant la guerre civile a entraîné d’autres mouvements migratoires, quand il ne s’agissait pas d’exils, voire d’exodes (comme l’ont montré les films du réalisateur taïwanais Wang Toon). Shanghai, la cité paradoxale, autant « perle de l’Orient » qui longtemps abrita les commerces de l’opium, du jeu et de la prostitution et qui fit rêver les cinéastes hollywoodiens (Josef von Sternberg par exemple), que foyer ayant accueilli en 1921 la création du Parti communiste chinois ; Shanghai, la cité longtemps divisée par la guerre (civile entre 1927 et 1950) des militants communistes et des partisans nationalistes dévoués au maître du Kuomintang, Tchang Kaï-chek : voilà ce dont rend compte la multitude kaléidoscopique de témoignages collectés par Jia Zhang-ke à l’occasion de son film. Surtout, I Wish I Knew substitue à la figure de la jeunesse désœuvrée des premiers films, puis à la figure ouvrière fragilisée des derniers films, une figure moins sociale que politique. Il ne s’agit plus de montrer la progressive pénétration de l’idéologie consumériste corrélative du lent effondrement de la centralité symbolique de la figure ouvrière, mais d’insister sur une autre dévastation : la ruine des affrontements politiques comme disparus ou déblayés du champ de vision contemporain. La question n’est plus celle des contradictions sociales résultant des orientations néolibérales d’un Etat chinois ainsi capable de combler les plus grands écarts idéologiques entre communisme et capitalisme. Désormais, cette question ressortit du domaine même des antagonismes politiques. Shanghai, cette lionne qui rugit de moins en moins comme le manifestent les ambiances musicales expressives de Lim Giong, expose ainsi un visage biface ou dual selon que l’on suive le fil économique attendu de sa munificence commerciale passée (le mercantilisme de l’époque coloniale) et présente (le centre financier de la mondialisation du capital), ou bien que l’on emprunte le sentier moins convenu des violents affrontements politiques entre les militants du Parti communiste de Mao et les partisans nationalistes de Tchang Kaï-Chek, puis des contradictions internes au communisme chinois entre la vieille garde aux commandes du Parti-Etat et la jeunesse des Gardes rouges qui avaient la faveur de Mao et qui rêvaient de refaire en 1966 la Commune de Paris de 1871. Parmi les 18 entretiens, certains témoignages expriment particulièrement les trois temps du triomphe politique ainsi que de son ellipse (ou de son éclipse : ce « désastre obscur » pour parler comme Alain Badiou) au profit de la restauration de la puissance économique de Shanghai.
C’est en premier lieu le (quatrième sur les 18) témoignage bouleversant de Wang Pei-min, la deuxième fille de Wang Xiao-he, un militant qui a rejoint en 1943 le Parti communiste chinois clandestin, et a été exécuté à la prison Tilanqiao de Shanghai en 1948, quelques mois seulement avant l’arrivée de l’Armée populaire synonyme de la victoire du Parti de Mao. L’histoire de cette femme qui n’a jamais connu son père, sinon au travers des récits de sa mère devenue folle à la suite de l’assassinat de son mari, ainsi que des quelques photographies que cette dernière avait conservées de lui, affirme la puissance subjective de l’idée communiste telle que l’a soutenue jusqu’à la mort Wang Xiao-he qui, s’il se savait mortel, n’ignorait pas que l’idée pour laquelle il se battait était quant à elle immortelle. Aux larmes de Wang Pei-min succèdent un plan noir, quelques éclats sonores, puis les photographies jaunies qui témoignent de l’immortalité de l’idée communiste telle qu’elle détermine l’inoubliable sourire de celui qui sait pourtant qu’il va mourir, et dont la joie efface sans difficulté la pâle mine de ses bourreaux l’emmenant en direction du peloton d’exécution. Quand Wang Pei-min évoque la folie de sa mère qui a bataillé pour faire reculer l’heure de l’exécution de son époux, qui a même réussi partiellement à faire repousser la date fatidique, menant sa tâche aux côtés d’autres conjointes de militants communistes condamnés à mort, et qui enfin a cru voir le visage de son aimé dans les rangs de l’Armée populaire délivrant Shanghai du joug répressif du Kuomintang, on se dit que l’on se trouve là devant la singulière et concrète expression de ce dont parle Alain Badiou quand il affirme : « Et c’est une des fonctions de l’Idée : projeter l’exception dans l’ordinaire des existences, remplir ce qui ne fait qu’exister d’une dose d’inouï. Convaincre mes entours individuels, époux ou épouse, voisins et amis, collègues, qu’il y a aussi la fabuleuse exception des vérités en devenir, que nous ne sommes pas voués au formatage de nos existences par les contraintes de l’Etat. Bien entendu, en dernier ressort, seule l’expérience nue, ou militante, de la procédure de vérité, forcera l’entrée de tel ou tel dans le corps-de-vérité. Mais pour l’amener au point où cette expérience se donne, pour le rendre spectateur, et donc déjà à demi acteur, de ce qui importe à une vérité, la médiation de l’Idée, le partage de l’Idée sont presque toujours nécessaires » (« L’idée du communisme », ibidem, p. 21). Si le film commence sur le récit de Yang Xiao-fo concernant l’assassinat par quatre hommes armés en 1933 de son père Yang Xing-fo, pionnier du mouvement chinois des Droits de l’Homme qui a rejoint l’Alliance Révolutionnaire Chinoise en 1910, puis se poursuit avec la guerre des gangs (les fameuses triades, tel le « Gang vert » raconté par Du Mei-ru dans le troisième entretien), la joyeuse projection de l’idée communiste permise par le « corps-de-vérité » de Wang Xiao-he, la projection de son caractère exceptionnel et inouï affirmant que l’idée communiste est la renversante expression de ce vivre en immortel qui défie la peur de mourir dont se nourrit pour se perpétuer la domination étatique, constitue un sommet de I Wish I Knew (comme de toute l’œuvre de Jia Zhang-ke). En même temps que cette acmé propre au film l’inscrit dans la grande série des films contemporains qui, sur le versant positif (Rachel de Simone Bitton : Des nouvelles du front cinématographique (15) : Rachel de Simone Bitton) ou négatif (United Red Army de Koji Wakamatsu : Des nouvelles du front cinématographique (5) : United Red Army (2008) de Koji WAKAMATSU), se sont consacrés à l’importante question de la subjectivation politique, et même plus précisément de la subjectivité militante.
Le neuvième témoignage proposé par Zhu Qian-sheng, membre de l’équipe shanghaienne qui était chargé d’encadrer idéologiquement le tournage de Chung Kuo (La Chine) réalisé par Michelangelo Antonioni en 1972, explicite sur un mode cette fois-ci plutôt comique la situation de pétrification de la Révolution culturelle à cette époque. La réification étatique l’a alors définitivement emporté sur les tentatives chaotiques de repolitiser la révolution communiste. Une simple preuve nous est donnée quand on apprend que le documentaire du grand cinéaste italien fut en son temps considéré par la fameuse « Bande des quatre » (l’épouse de Mao, Jiang Qing, ainsi que Zhang Chunqiao, Yao Wen-yuan et Wang Hong-wen, tous exclus du Parti en 1977 pour avoir fomenté la Révolution culturelle, et tous jugés en 1980) comme de « l’herbe vénéneuse impérialiste », et qui en conséquence a exigé de sérieuses explications de la part du narrateur. Le fait même que Zhu Quian-sheng nous raconte aujourd’hui cette histoire, autrement dit le fait qu’il ait survécu à une exécution plus que probable à laquelle ont été préférées plusieurs séances obligatoires d’autocritique publique, manifeste un pouvoir d’Etat davantage préoccupé par le contournement d’une possible dérive stalinienne au profit d’une ouverture commerciale synonyme de sortie économique et apolitique de l’échec de la Révolution culturelle. Et le fait même que nous puissions avec l’interviewé rire de cette histoire explicite les processus de dépolitisation entrepris par le pouvoir post-maoïste, restaurant ainsi la puissance financière de Shanghai au bénéfice idéologique de la perpétuation de l’Etat chinois (dans l’arrière-pays continental comme le montre la plupart des films de Jia Zhang-ke, cette prestigieuse restauration financière aura été connexe de la déstructuration de la paysannerie et de la classe ouvrière relative à la réorientation industrielle dopée par l’introduction de capitaux étrangers). Les deux derniers témoignages offerts par Yang Huai-ding (surnommé « Yang le Millionnaire », il gagne en 1988 son premier lingot d’or en négociant des bons du Trésor) et Han Han (cet écrivain de 28 ans dont les réussites commerciales lui ont permis de devenir coureur automobile) affirment en deux temps le stade suprême d’un capitalisme chinois triomphant : d’un côté, l’argent facile obtenu par le prolétaire par-dessus l’idéal ouvrier ou travailliste grâce aux mécanismes spéculatifs sur de la dette nationale ; de l’autre, le consumérisme tapageur de la nouvelle « classe de loisirs » (Thorstein Veblen) dont « la consommation ostentatoire » signe l’intégration de la société chinoise dans le grand bain de la mondialisation du capital, quels que soient les démentis idéologiques (cette conclusion est structuralement homologue aux derniers témoignages de 24 City montrant l’écroulement de l’ethos ouvrier au profit de l’éthique capitaliste). La béance séparant le sourire éclatant du militant qui sait devoir mourir pour la cause communiste, et dont la joie est soutenue par l’immortelle portée d’un idéal partagé par des millions de camarades en Chine et dans le reste du monde, et les demi-sourires des nouveaux bourgeois d’abord surpris puis blasés de s’être aussi rapidement enrichis est celle du vide politique organisé par l’Etat chinois au nom de la consécration de sa puissance économique mondiale. I Wish I Knew, avant d’être le titre du film de Jia Zhang-ke (et en cela on pense aussi aux films de Wong Kar-waï souvent inspirés de titres de chansons de variétés populaires), fut celui d’une chanson du pianiste jazz Billy Taylor d’abord enregistrée par Nina Simone, puis par Solomon Burke et Ray Charles : « I wish I knew how It would feel to be free » dit cette chanson considérée aux Etats-Unis comme un hymne aux droits civiques. Cet air étasunien dégageant un sentiment de nostalgie pour l’époque impérialiste occidentale qui est profondément antithétique à la puissance de l’idée communiste affirme l’œuvre restauratrice du capitalisme réalisée par un Etat chinois qui cherche ainsi à liquider la mémoire collective de l’épisode historique de la Révolution culturelle, et qui propose une version pseudo-communiste d’un autoritarisme étatique qui ne peut pas signifier autre chose que la trahison pratique de l’idée communiste (mais justement, au moins comme idée, le communisme n’est pas prêt de mourir). Et si restaurer signifie liquider et (faire) oublier le geste révolutionnaire, alors les époques de restauration qui succèdent aux révolutions manquées annoncent aussi dialectiquement des révolutions à venir qui ne manqueront pas - il le faut - de réussir puisqu’elles s’accompliront dans la décisive distinction d’avec l’Etat.

Suprême ruse de la raison hégélienne (bis repetita) : si Shanghai représente aujourd’hui l’un des fleurons à la fois étatique et international du capital mondial, c’est parce que la mégalopole incarne la relève synthétique du mercantilisme sous influence coloniale et occidentale des premiers temps de la modernité effectuée par l’autoritarisme du pouvoir d’Etat post-maoïste (cf. Giovanni Arrighi, Adam Smith à Pekin. Les promesses de la voie chinoise, éd. Max Milo, 2009). La perversité de ce renversement dialectique du matérialisme dialectique traditionnelle qui prévoyait mécaniquement l’avènement universel du communisme parachève la désertification ou la liquidation du communisme comme hypothèse politique dés-identifiée de la question étatique. Le triomphe actuel de Shanghai devient alors in fine autant la défaite réelle du communisme (mal) compris comme étatisation autoritaire de la société que la promesse d’un autre communisme possible qui aurait dialectiquement dépassé la médiation étatique. Le communisme libertaire pourrait en être le nom, pourquoi pas ? Quand on aura enfin rappelé que la majeure partie de la dette extérieure étasunienne comme européenne est entre les mains de la Chine, on aura définitivement compris que l’on a alors tout intérêt à suivre le devenir du peuple chinois tel que nous l’exposent admirablement I Wish I Knew ainsi que tous les films de Jia Zhang-ke, tant son devenir nous concerne, tant il regarde le nôtre. « "Communiste" est aujourd’hui le nom du parti qui gouverne la nation la plus peuplée et l’une des puissances capitalistes les plus prospères du monde. Ce lien présent entre le mot "communisme", l’absolutisme étatique et l’exploitation capitaliste doit être présent à l’horizon de toute réflexion sur ce qu’il peut aujourd’hui signifier » (Jacques Rancière, « Communistes sans communisme ? », ibid., p. 231).


 Vérifiez sur
Vérifiez sur